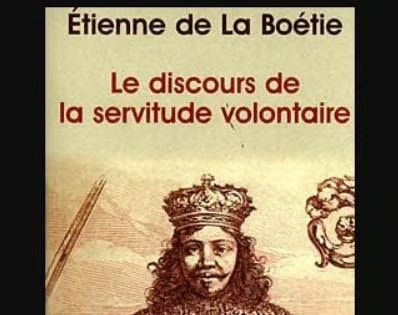Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne
Parcours : « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux »
une œuvre et une autrice singulières

Françoise de Graffigny (1695-1758), écrivaine du siècle des Lumières, occupe une place à part dans l’histoire littéraire. Issue de la noblesse lorraine, elle s’impose difficilement dans un univers dominé par les hommes, mais parvient à se faire reconnaître grâce à son roman épistolaire Lettres d’une Péruvienne publié en 1747. Le succès est immense : l’ouvrage connaît de nombreuses rééditions et traductions.
À travers le personnage de Zilia, une princesse inca enlevée par les Espagnols puis transportée en France, Graffigny propose une critique subtile de la société française, observée par le regard étranger d’une héroïne naïve mais lucide. Cette perspective originale s’inscrit pleinement dans la tradition des « regards croisés » initiée par Les Lettres persanes de Montesquieu (1721).
Le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » invite justement à réfléchir à la découverte d’un monde nouveau, à la rencontre entre cultures, mais aussi à l’épreuve du décentrement et à la mise en question des valeurs établies.
Françoise de Graffigny (1695-1758)
Françoise d’Issembourg d’Happoncourt, plus connue sous le nom de Madame de Graffigny, naît à Nancy en 1695, dans une famille de petite noblesse lorraine.
- Mariage et difficultés : En 1712, elle épouse François Huguet de Graffigny, officier ruiné, violent et brutal. Le couple se sépare en 1723 après une vie conjugale malheureuse. Françoise connaît alors une existence instable, marquée par des soucis financiers.
- Vie à la cour et relations : Elle fréquente la cour de Lorraine et se lie avec plusieurs figures intellectuelles de son temps, dont Voltaire et Madame du Châtelet, qu’elle côtoie à Cirey. Cette immersion dans un milieu lettré stimule son goût pour la littérature.
- Carrière littéraire : Installée à Paris dans les années 1730, elle publie en 1747 son grand succès, Lettres d’une Péruvienne, roman épistolaire qui la rend célèbre dans toute l’Europe. L’ouvrage, traduit en plusieurs langues, connaît de nombreuses rééditions au XVIIIᵉ siècle. Elle est ainsi l’une des femmes écrivaines les plus lues de son époque.
- Engagement littéraire : Par ses écrits, elle défend une réflexion critique sur les mœurs, la condition des femmes et les inégalités sociales. Elle s’inscrit pleinement dans le mouvement des Lumières, tout en apportant une voix originale, féminine et sensible.
- Autres œuvres : Elle écrit aussi pour le théâtre (Cénie, 1750, drame bourgeois dans la lignée de Diderot et Sedaine), et entretient une abondante correspondance, qui constitue une source précieuse pour l’histoire littéraire et culturelle du XVIIIᵉ siècle.
- Mort : Elle meurt à Paris en 1758, auréolée d’un prestige certain mais toujours marquée par les difficultés matérielles qui ont jalonné sa vie.
Analyse de l’œuvre : Lettres d’une Péruvienne
Fiche bac en 9 points
1) Contexte, place et singularité
- Publication : 1747, au cœur du XVIIIᵉ siècle.
- Genre : roman épistolaire à voix unique (majoritairement), qui renouvelle la veine des Lettres persanes en la féminisant et en la psychologisant.
- Singularité : voix étrangère + voix féminine. Le décentrement (regard venu du Pérou) s’adosse à un discours d’émancipation : Graffigny ne se contente pas d’un exotisme décoratif, elle s’en sert comme instrument critique et comme levier d’autonomie pour son héroïne.
2) Dispositif narratif : une forme au service des idées
- Épistolarité : l’adresse à Aza (fiancé inca) instaure une intimité et une sincérité de ton ; l’immédiateté des lettres produit l’effet-découverte. Plus loin, Zilia écrit aussi à des Européens (dont Déterville), signe d’une acculturation en cours.
- Progression : de la sidération (enlèvement, naufrage, sauvetage) à l’observation méthodique des mœurs françaises, puis à la délibération (que faire de sa vie ?) et enfin au choix (refus des tutelles).
- Langage et traduction : le passage des quipus (cordelettes incas) à l’alphabet matérialise l’entrée de Zilia dans une autre culture et interroge la médiation des signes : écrire, c’est construire sa subjectivité et conquérir un espace d’action.
3) Personnages et système relationnel
- Zilia : héroïne lucide, sensibilité vive, intelligence critique. Sa trajectoire suit un arc d’émancipation : de la dépendance affective à l’autonomie morale et matérielle.
- Aza : fiancé lointain, figure idéalisée puis reconfigurée par l’épreuve de la distance ; le lien se désidéalise.
- Déterville : bienfaiteur européen, figure ambivalente de la galanterie éclairée ; il représente la tentation d’un nouvel asservissement (affectif/social), que Zilia déjoue en posant des conditions d’égalité.
4) Thématiques majeures
a) Altérité et critique sociale
- Renversement du regard : c’est la France qui devient l’objet d’ethnographie. Zilia dénaturalise les hiérarchies, l’ostentation, le luxe, la futilité mondaine.
- Culturalisme des Lumières : la comparaison Pérou/Europe engage un relativisme raisonné : aucune coutume n’est absolue, toute norme est située.
b) Condition féminine et émancipation
- Mariage et dépendance : Zilia constate que le mariage européen reconduit des rapports de domination (économique, juridique, symbolique).
- Savoir et autonomie : l’éducation (apprendre la langue, lire, écrire, compter, créer) ouvre la voie à la liberté. L’héroïne revendique une existence hors tutelle.
- Féminisme des Lumières avant la lettre : la voix narrative met à l’épreuve le modèle patriarcal et réclame la réciprocité dans l’amour.
c) Amour, sensibilité, raison
- Désidéalisation d’Aza : l’amour « naturel » n’immunise pas contre la défaillance ; l’idéal se heurte au réel.
- Galanterie française : politesse/jeu social vs authenticité ; Zilia sépare le sentiment (vrai) de la convenance (fausse).
- Éthique de la liberté : aimer n’est pas s’asservir ; le lien juste suppose égalité, consentement et respect.
d) Économie, circulation, échanges
- Les salons, le jeu, la mode, l’argent : autant de réseaux d’influence. Zilia repère les logiques d’intérêt dissimulées sous les codes de la sociabilité. L’« échange » (commercial, symbolique, sentimental) devient un analyseur de la société.
e) Écriture et pouvoir des signes
- la littérature est puissance de traduction du monde et de transformation de soi.
- L’épistolaire permet de mettre en scène la pensée en train de se faire, de la stupeur à la justification éthique.
5) Esthétique et procédés d’écriture
- Registre de la sensibilité : pathétique retenu, lexique des affects, notations fines sur le corps (traces de l’arrachement, fatigue, larmes, rougeur) qui ancrent l’émotion.
- Ironie et antithèses : Zilia confronte les mots et les choses (la « politesse » qui humilie, la « liberté » sans droits).
- Rhétorique de l’étonnement : interrogatives, exclamatives, scènes-tableaux (à l’opéra, dans les salons, au bal) qui cristallisent la critique pittoresque.
- Temporalité progressive : chaque lettre marque une étape : comprendre, juger, décider. La forme cadençe l’apprentissage.
6) Déroulé dramatique
- Arrachement et sauvetage : naissance d’un regard vierge.
- Apprentissage linguistique et social : Zilia conquiert des outils critiques.
- Épreuves de la mondanité : dévoilement des intérêts et des rôles.
- Reconfiguration des liens (Aza/Déterville) : tri des attachements.
- Choix final d’existence : primat de l’autonomie sur la fusion sentimentale.
7) Idées directrices pour l’oral/dissertation
- Thèse A (critique) : l’Europe de la civilité masque des inégalités ; la galanterie est une fiction qui tient les femmes en dépendance.
- Thèse B (émancipation) : l’éducation et l’écriture rendent possible une subjectivité libre ; Zilia invente un modèle d’amour égalitaire qu’elle préfère à toute soumission.
- Thèse C (relativisme) : l’altérité sert à désabsolutiser nos mœurs ; la vérité naît de la comparaison et de la distance.
8) Passages-clés à commenter (pistes)
- Premières lettres : choc de l’exil, fonction vitale de l’écriture.
- Scènes de salon/opéra : critique du spectacle social et du luxe.
- Lettres sur l’éducation des femmes : plaidoyer implicite pour le savoir.
- Lettres tardives : redéfinition de l’amour et choix d’autonomie.
9) Portée et postérité
- Œuvre fondatrice d’une sensibilité féminine des Lumières : elle combine décentrement culturel et affirmation de soi.
- Dialogue avec Montesquieu (regard étranger), annonce Rousseau (sensibilité) et préfigure les écritures féministes ultérieures (liberté, instruction, indépendance économique et symbolique).
- Lettres d’une Péruvienne n’est pas qu’un roman d’exotisme : c’est un laboratoire d’émancipation. La voix de Zilia, en s’appropriant langue et écriture, dévoile les rapports de pouvoir et arrache l’amour à la logique de possession. L’œuvre tresse critique sociale, philosophie pratique de la liberté et poétique de la sensibilité.
Une œuvre des Lumières au féminin
Publié en 1747, Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny s’inscrit dans la vogue des romans épistolaires et des récits de décentrement propres au XVIIIᵉ siècle.
À travers la voix de Zilia, jeune Inca enlevée lors de la conquête du Pérou puis transportée en France, l’autrice construit un regard neuf sur la société européenne.
Ce texte, à la croisée du roman sentimental et du traité philosophique, permet à la fois de questionner l’altérité culturelle et de réfléchir à la condition des femmes dans l’Europe des Lumières.
I. Une fiction de l’exotisme et du décentrement
Le choix d’une héroïne étrangère
- Zilia, jeune Inca, est déracinée de son monde lors de la conquête espagnole.
- Son regard naïf et candide sur la France crée un effet de contraste : ce que les Européens trouvent naturel devient étrange ou choquant à travers ses yeux.
Un dispositif épistolaire efficace
- Les lettres qu’elle écrit à son fiancé Aza lui permettent d’exprimer ses sentiments intimes et ses observations.
- L’écriture devient un instrument de survie et de réflexion : la correspondance remplace le lien perdu.
Un récit qui exploite le goût du public pour l’exotisme
- Le Pérou et ses coutumes idéalisées servent de miroir critique.
- L’ailleurs n’est pas qu’un décor : il est un outil de réflexion philosophique sur l’Europe.
II. Une critique implicite de la société française
La découverte des inégalités sociales
- Zilia est frappée par la pauvreté du peuple face à l’opulence des élites.
- Ce contraste lui paraît absurde et injuste : la société française est marquée par des hiérarchies arbitraires.
La dénonciation de la condition féminine
- Les femmes françaises, prisonnières des conventions, apparaissent soumises à la mode, au mariage ou à la domination masculine.
- Zilia, qui rêve d’indépendance, se heurte à des limites que la société française impose aux femmes.
La critique de l’ethnocentrisme européen
- Les Européens se croient supérieurs, mais aux yeux de Zilia, leurs mœurs sont étranges et parfois barbares.
- Le roman inverse les perspectives : c’est l’Europe qui devient l’objet de l’étonnement.
III. Une œuvre qui interroge l’émancipation individuelle et féminine
Une héroïne en quête d’autonomie
- Arrachée à son monde, Zilia doit se réinventer.
- Elle refuse de dépendre d’un homme pour exister et revendique son droit à penser et à choisir sa vie.
Une réflexion sur l’amour et la liberté
- L’amour d’Aza, menacé par la distance, symbolise l’attachement au passé.
- Mais Zilia découvre que l’amour ne doit pas être synonyme d’asservissement : elle rêve d’un lien fondé sur l’égalité.
Une figure pionnière du féminisme
- En dénonçant les contraintes imposées aux femmes et en valorisant l’éducation et la liberté de choix, Graffigny ouvre la voie à une pensée féministe avant la lettre.
- Son roman dépasse la simple fiction sentimentale pour devenir une prise de parole politique et sociale.
Lettres d’une Péruvienne est bien plus qu’un roman d’aventures ou qu’un récit exotique : c’est une œuvre des Lumières, qui met en scène l’expérience de l’altérité pour critiquer la société française et en particulier la condition féminine.
À travers Zilia, Françoise de Graffigny propose une réflexion sur la liberté, l’égalité et l’émancipation, montrant que la découverte d’un nouvel univers est aussi une invitation à changer de regard sur soi-même et sur sa propre culture.
Analyse du parcours : Un nouvel univers s’est offert à mes yeux
Sens et portée du parcours
Le parcours intitulé « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » invite à réfléchir à l’expérience de la découverte, de l’altérité et du décentrement.
Il ne s’agit pas seulement de voyager dans un autre espace géographique, mais aussi de se confronter à un monde inconnu, à d’autres valeurs, à d’autres codes sociaux ou culturels. Cette expérience bouleverse les repères, suscite tour à tour l’émerveillement et l’effroi, et conduit à une redéfinition de soi-même.
Ainsi, le parcours interroge : que signifie « voir autrement » ? En quoi la découverte d’un univers nouveau permet-elle de porter un regard critique sur sa propre société et d’élargir son horizon intérieur ?
I. L’émerveillement de la découverte
Un monde étranger perçu comme une révélation
- Découvrir un nouvel univers, c’est éprouver une sensation de nouveauté radicale.
- Les paysages, les coutumes, les langues, tout apparaît comme une richesse inédite.
- Le regard est marqué par l’étonnement, parfois par le ravissement : l’autre devient un miroir de la curiosité humaine.
La mise en lumière des limites de son propre monde
- Voir un univers inconnu, c’est comprendre que son propre univers n’est pas unique ni absolu.
- La confrontation avec l’altérité relativise les certitudes, met à distance les habitudes, ouvre à la pluralité des cultures.
L’accès à une conscience élargie
- La découverte d’un nouvel univers transforme l’expérience intime : on ne revient jamais identique d’une telle rencontre.
- Elle permet de passer d’un regard fermé à une vision élargie du monde, où la diversité devient source d’enrichissement.
II. L’expérience du choc et de la désillusion
La perte des repères
- Face à un univers inconnu, l’individu se heurte à l’incompréhension. Les valeurs, les rites, les hiérarchies ne sont pas les mêmes.
- Cette expérience provoque un sentiment de désorientation, de solitude, voire d’exil.
La critique implicite de la société d’accueil
- Le regard neuf révèle aussi ce qui choque ou blesse : les inégalités, la corruption des mœurs, la violence des rapports sociaux.
- L’univers étranger peut apparaître comme un espace d’oppression plutôt que d’ouverture.
Le déchirement identitaire
- Celui qui découvre un nouvel univers est pris entre deux mondes : il ne se reconnaît plus totalement dans le sien, mais ne parvient pas à s’intégrer pleinement à l’autre.
- Ce décentrement peut se traduire par une crise de l’identité et une quête de soi.
III. Une réflexion sur la liberté, l’égalité et l’humanité
L’altérité comme miroir critique
- Le regard étranger dévoile l’absurde de certaines coutumes, le caractère arbitraire des normes sociales.
- Ce décentrement devient une arme philosophique : il permet de dénoncer la tyrannie, l’injustice, la domination.
Un chemin vers l’universalité
- La découverte d’un nouvel univers ne conduit pas seulement à la critique : elle ouvre aussi la voie à une vision universelle de l’humanité.
- Au-delà des différences culturelles, l’expérience révèle des valeurs communes : l’aspiration à la dignité, à l’amour, à la liberté.
La littérature comme espace d’expérimentation
- Les récits épistolaires, les utopies, les récits de voyage sont des laboratoires de pensée : ils permettent au lecteur d’expérimenter, par procuration, l’étonnement devant un univers nouveau.
- Le parcours devient ainsi un appel à la lecture comme ouverture au monde et aux autres.
Le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » ne se limite pas à la simple curiosité exotique : il interroge les effets profonds de la rencontre avec l’altérité.
Découvrir un monde nouveau, c’est à la fois s’émerveiller et s’inquiéter, perdre ses repères et agrandir son horizon, se sentir étranger et se reconnaître humain parmi les autres.
En ce sens, le parcours s’inscrit pleinement dans l’esprit des Lumières : faire de l’expérience de l’autre une source de réflexion critique et d’émancipation, et de la littérature un outil de liberté intérieure.
 Lettres d'une Péruvienne, Françoise de Graffigny / Un nouvel univers s'est offert à mes yeux
Lettres d'une Péruvienne, Françoise de Graffigny / Un nouvel univers s'est offert à mes yeux
- Lettres d'une Péruvienne de Graffigny, analyse de l'oeuvre et du parcours
- " Avertissement ", analyses linéaire et littéraire, Lettres d'une Péruvienne
- Lettre I, études linéaire et littéraire
- Lettre I, "Cette maison que j'ai jugée si grande... " Etude linéaire
- Lettre IV, 2 études linéaires et un commentaire littéraire
- Lettre XI, analyse linéaire et 2 études littéraires
- Lettre XVII, étude linéaire et 6 questions de grammaire corrigées
- Lettre XX, commentaires linéaire et littéraire
- Lettre XXX, études linéaire et littéraire. Analyse de citations Montaigne / Diderot en lien Graffigny
- Le roman épistolaire de Graffigny entre confession intime et critiques des Lumières