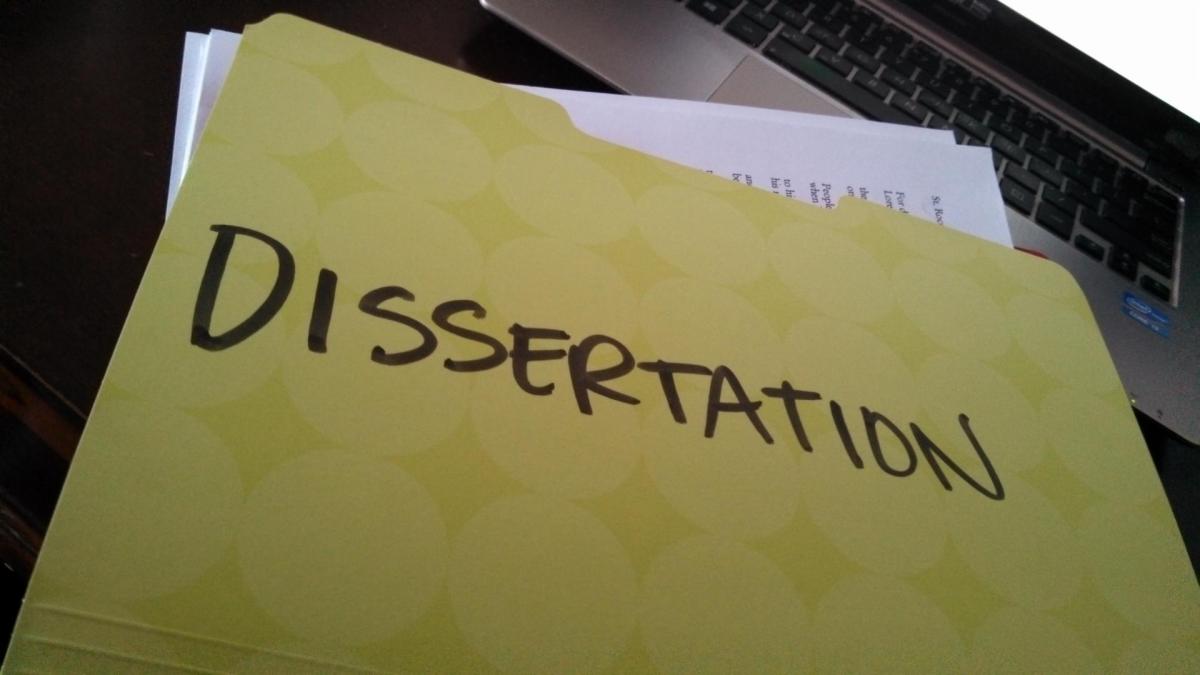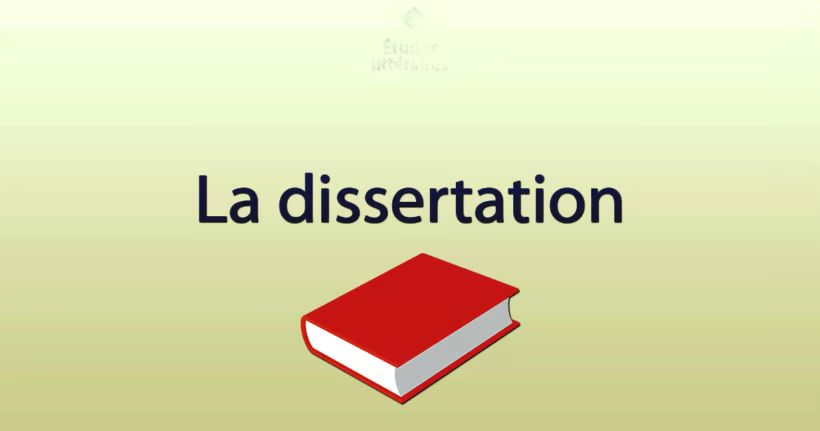Sujet :
Dans Lettres d’une Péruvienne, Françoise de Graffigny fait entendre la voix d’une étrangère arrachée à son pays et confrontée aux mœurs européennes.
Pensez-vous que le roman épistolaire permette avant tout d’exprimer une confession intime ou de proposer une critique de la société ?
Ce sujet met en tension les deux fonctions principales de l’écriture épistolaire dans le roman :
- La confession intime → Zilia écrit ses souffrances, ses désirs, ses doutes, ses sentiments amoureux, ce qui rapproche le texte de l’aveu et de l’introspection.
- La critique de la société → à travers son regard neuf, elle interroge les mœurs, les institutions, la condition féminine, et propose une réflexion qui rejoint les débats des Lumières.
- Il invite à réfléchir sur la double portée du roman : personnelle et universelle.
Au XVIIIᵉ siècle, le roman épistolaire séduit de nombreux auteurs parce qu’il permet de donner une voix directe et vivante à leurs personnages. L’illusion d’une parole spontanée rend possible à la fois l’expression des émotions et la mise en cause des mœurs. Dans Lettres d’une Péruvienne (1747), Françoise de Graffigny imagine la correspondance fictive d’une princesse inca, Zilia, enlevée de son pays et confrontée à la civilisation européenne. Ses lettres disent à la fois la douleur de l’exil et la critique d’un monde qui lui est étranger.
On peut donc se demander : le roman épistolaire permet-il avant tout à Graffigny d’exprimer une confession intime ou de proposer une critique de la société ?
I. Une confession intime : la voix sensible d’une femme déracinée
La lettre, une parole intime et sincère
Chaque lettre est adressée à Aza, le fiancé resté au Pérou. Cela crée une illusion d’authenticité : Zilia semble se confier directement à lui.
Zilia confie ses émotions les plus profondes : douleur de la séparation, nostalgie du Pérou, solitude
Exemple : dans la lettre I, elle exprime son désespoir – « je ne vois plus que des étrangers » – qui marque le choc de la séparation.
Un espace d’analyse des sentiments
Zilia décrit son trouble, son angoisse, mais aussi son espoir. L’épistolaire est comme un journal des émotions.
Elle raconte ses hésitations entre fidélité à Aza et attirance pour Déterville : le lecteur suit son évolution psychologique.
On retrouve ici le goût du XVIIIᵉ pour l’analyse psychologique.
L’écriture comme affirmation de soi
En écrivant, Zilia se construit une identité : au fil des lettres, elle s’affirme comme une femme qui choisit l’indépendance.
Dans la lettre finale, elle refuse de se marier, préférant « conserver sa liberté » : la confession intime devient un instrument d’émancipation.
La dimension intime est donc essentielle : le lecteur découvre un univers intérieur sensible, ce qui correspond au parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux ».
II. Une critique sociale et politique par le regard de l’étrangère
Un regard neuf et étonné sur la France
Zilia observe avec naïveté mais lucidité les mœurs françaises, ce qui fait ressortir leur étrangeté.
Exemple : dans la lettre XVII, elle s’étonne de voir les femmes « s’exposer avec tant de hardiesse » et critique la frivolité de leurs tenues.
La dénonciation de la condition féminine
Zilia remarque l’absence de liberté des femmes françaises, soumises aux conventions sociales et au mariage.
Exemple : elle s’indigne que leur éducation se limite aux « amusements frivoles » alors qu’elles pourraient être instruites et égales aux hommes.
Graffigny rejoint ainsi les combats des Lumières pour l’égalité entre hommes et femmes.
Une réflexion universelle sur l’égalité
Derrière l’exotisme, Graffigny dénonce l’ethnocentrisme européen et défend une conception plus juste des rapports entre peuples et sexes.
Comme Montesquieu dans Lettres persanes, l’étrangère sert de miroir critique : à travers son regard, c’est toute la société française qui est interrogée.
Le roman dépasse la simple confession pour devenir une satire sociale et un manifeste pour l’égalité, dans l’esprit des Lumières.
III. Un équilibre : l’intime au service de la critique
La sensibilité comme moyen de convaincre
Le lecteur est touché par les émotions de Zilia et accepte plus facilement ses jugements sur la société.
Sa douleur personnelle rend sa critique plus crédible : elle parle d’expérience, pas d’abstraction.
L’épistolaire comme forme double
La lettre allie plaisir du récit personnel et force argumentative : l’intime et le social se mêlent naturellement.
Exemple : ses confidences sur son malheur débouchent souvent sur une réflexion générale sur l’injustice.
Un nouvel univers intérieur et social
Univers intime : l’évolution d’une jeune femme vers l’indépendance.
Univers social : la découverte critique d’une société qui n’est pas la sienne.
Le parcours bac est pleinement éclairé : l’œuvre propose un double « nouvel univers » au lecteur.
Les deux fonctions ne s’opposent pas : la confession nourrit la critique, et la critique donne un sens à la confession.
Lettres d’une Péruvienne est donc à la fois un roman de confession intime et une critique sociale. Par la voix de Zilia, Graffigny exprime la douleur d’une femme exilée et ses combats intérieurs, mais elle utilise aussi ce regard étranger pour dénoncer les injustices de la société française et l’inégalité des sexes.
L’œuvre illustre parfaitement le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » : elle ouvre au lecteur un monde sensible (les émotions d’une femme) et un monde intellectuel (la critique des Lumières).
On peut rapprocher ce double mouvement d’autres romans épistolaires comme Lettres persanes de Montesquieu ou La Nouvelle Héloïse de Rousseau, qui associent eux aussi émotion et réflexion.


 Sujet 1 :
Sujet 1 :