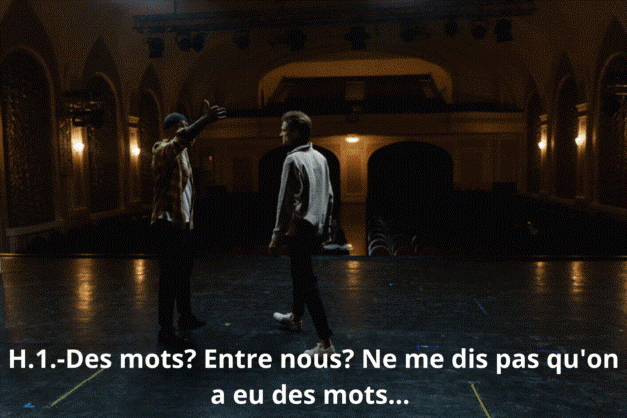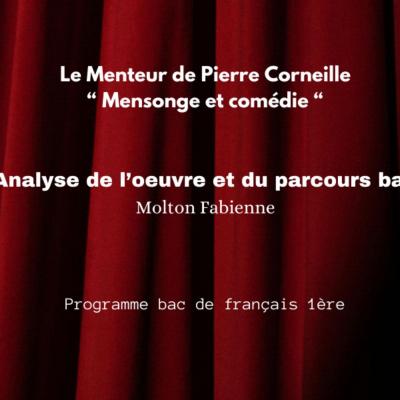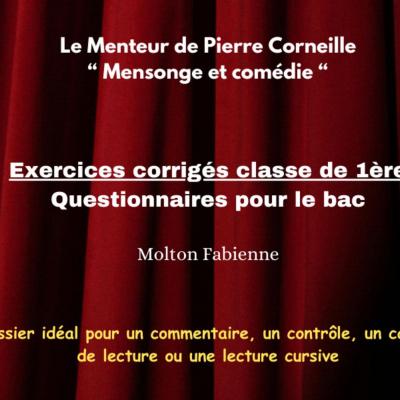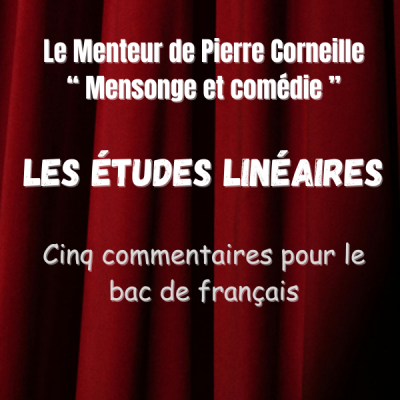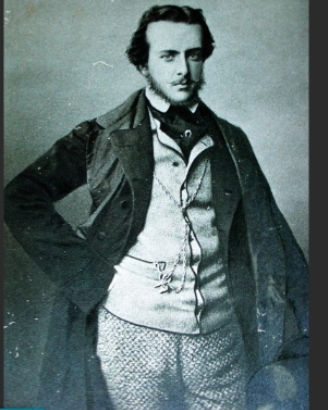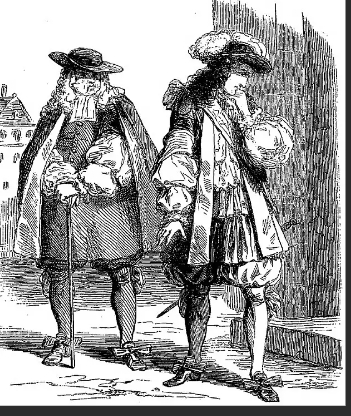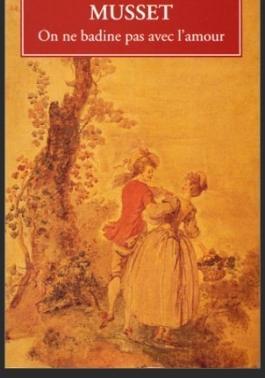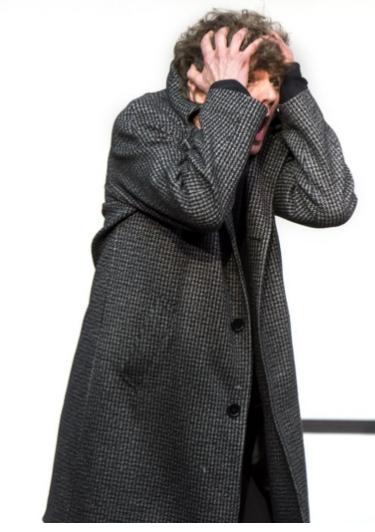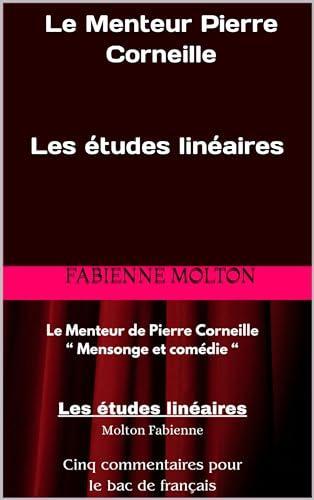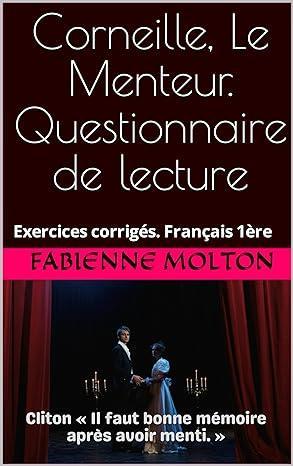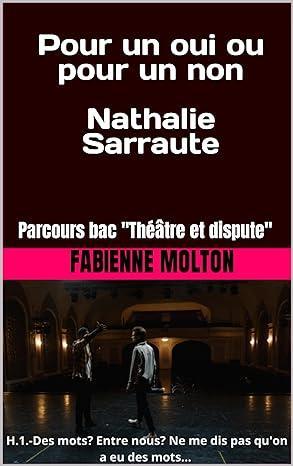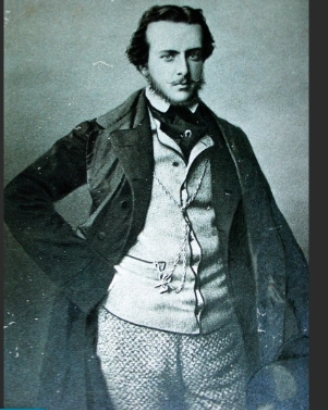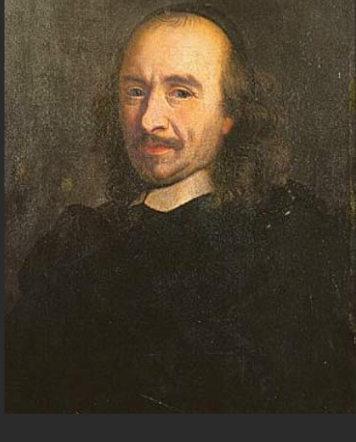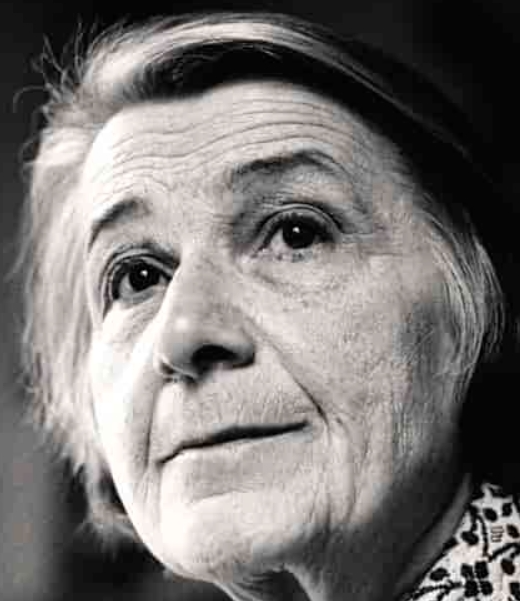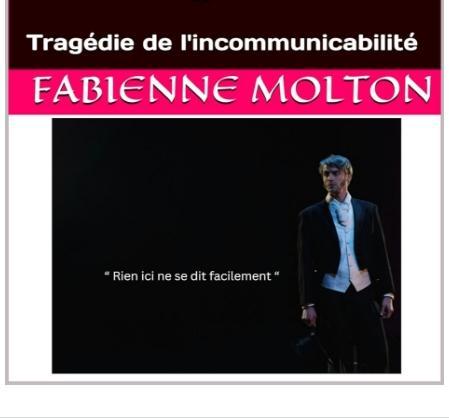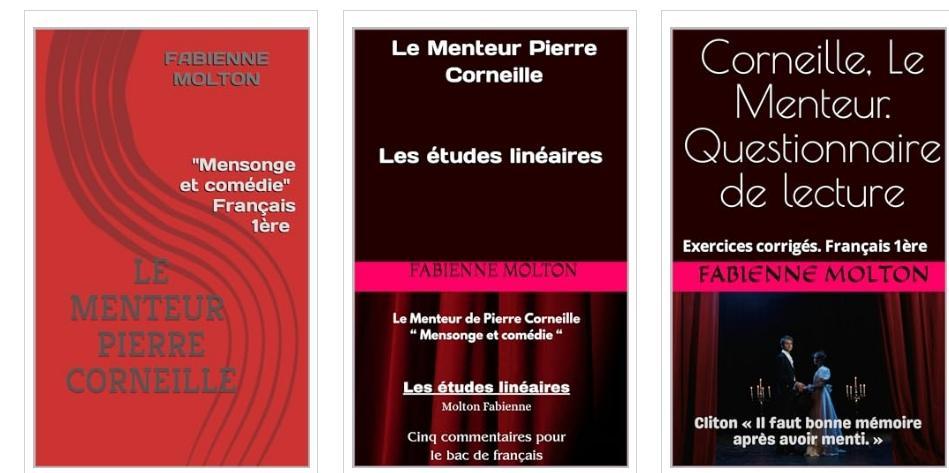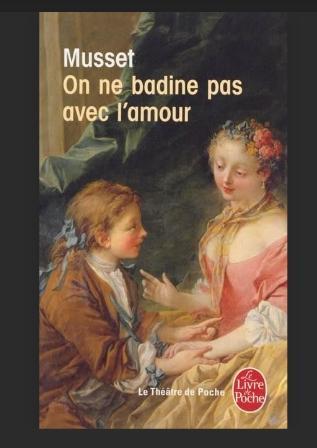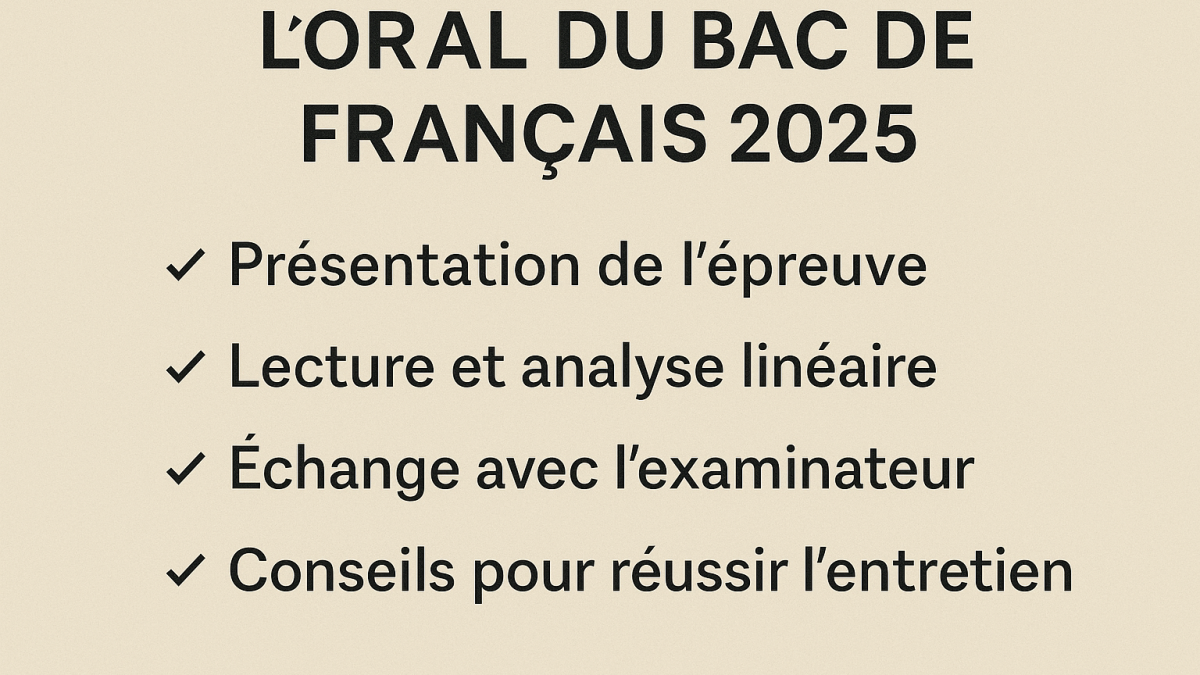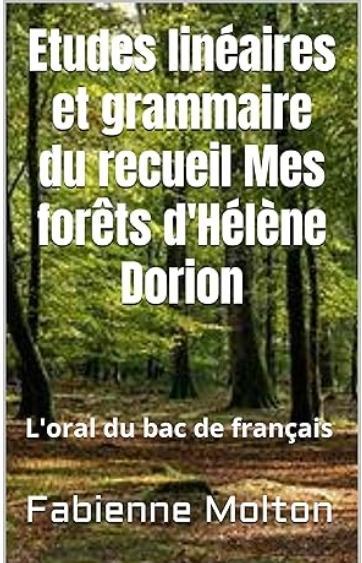Extrait 1
Une écriture fragmentée
Les points de suspension
Fréquents, ils s'insèrent dans les dialogues et en font partie intégrante. Ils ont une valeur énonciative. Importance de ce signe, les points de suspension en fin de phrase valorisent les arguments de H1 et H2. Signe d'un inachèvement, ils informent que les mots se perdent tout en désignant de manière caractéristique l'écriture de Sarraute. Ils marquent la fin et l'ouverture sur autre chose dans un dialogue qui s'effrite, dans un prolongement flou.
Ils prolongent les mots mais donnent souvent une allure circulaire au discours des personnages enfermés dans leurs phrases contradictoires.
Ils sont prêts à accueillir les non-dits, ils suggèrent plus que les mots dans le temps du discours. Ils transcrivent le paraverbal.
Exemple :
"C'est bien... ça..."
La fameuse phrase à l'origine de la dispute entre H1 et H2 rapportée par H1, notons que l'intervalle entre "c'est bien" et "ça" marque par les points de suspension, un temps, un étirement, un allongement. Cela participe du duel théâtral : l'énoncé est à l'origine du drame entre les deux personnages, il prend en compte le rapport entre ce qui est dit et la manière dont il est prononcé.
"C'est bien... ça...", cet énoncé anodin fait l'objet d'un commentaire de H2 :
⦁ H1. Et alors je t'aurais dit : "C'est bien, ça?"
⦁ H2. Soupire - Pas tout à fait ainsi... il y avait entre "C'est bien" et "ça" un intervalle plus grand : "C'est biiien.... ça". Un accent mis sur "bien".... un étirement : "biiien..." et un suspens avant que "ça" arrive... ce n'est pas sans importance...
⦁ H1. Et ça ... Oui, c'est le cas de le dire... Ce "ça" précédé d'un suspens qui t'a poussé à rompre...
Suspendre un discours par un signe de ponctuation
L'aposiopèse
Définition : suspension du discours au moyen du signe de
ponctuation
Aposiopèse sarrautienne
Extrait 2
Le tropisme devient le moteur de l'action

"Mon premier livre contenait en germe tout ce que, dans mes ouvrages suivants, je n'ai cessé de développer. Les tropismes ont continué d'être la substance vivante de tous mes livres"
Extrait de la préface de L’Ere du soupçon
« J’ai commencé à écrire Tropismes en 1932. Les textes qui composaient ce premier ouvrage étaient l’expression spontanée d’impressions très vives, et leur forme était aussi spontanée et naturelle que les impressions auxquelles elles donnaient vie.
Je me suis aperçue en travaillant que ces impressions étaient produites par certains mouvements, certaines actions intérieures sur lesquelles mon attention s’était fixée depuis longtemps. En fait, depuis mon enfance.
Ce sont des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience; ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver, et qu’il est possible de définir. Ils me paraissaient et me paraissent encore constituer la source secrète de notre existence… ».
Extrait de la préface de L’Ere du soupçon
Tropisme est un terme emprunté au langage scientifique, il signifie déplacement ou transformation d'un élément sous l'effet de stimulis extérieurs.
Il renvoie du point de vue littéraire à des sentiments intenses, fugaces, inexpliqués : conventions sociales, phrases stéréotypées.
Les tropismes sont définis comme "action dramatique", c'est-à-dire, dont "le déploiement constitue de véritables drames". Ils se manifestent par le dialogue, les profondeurs du langage sont explorés depuis la conversation jusqu'à la sous-conversation.
Le tropisme est ré-action, il se fait le moteur de l'action.