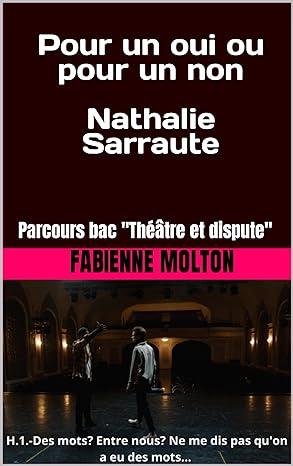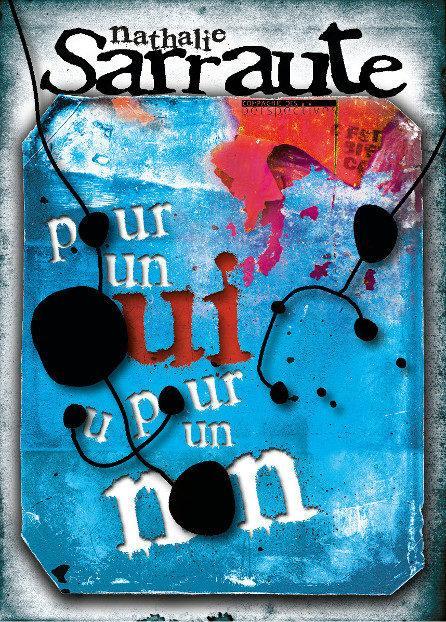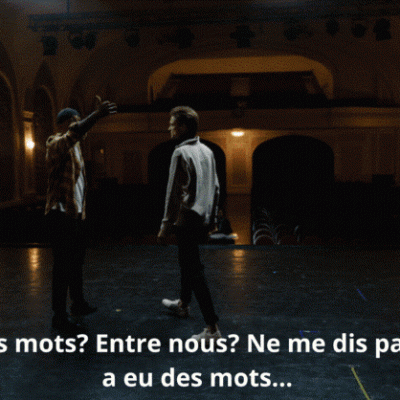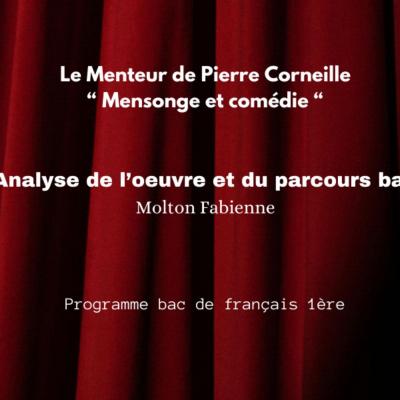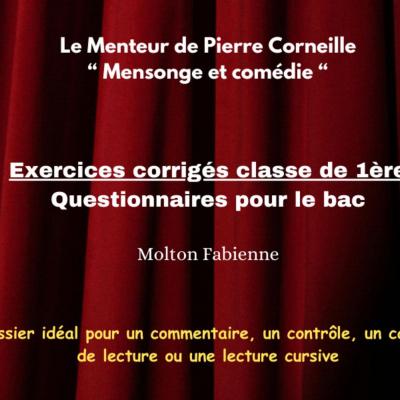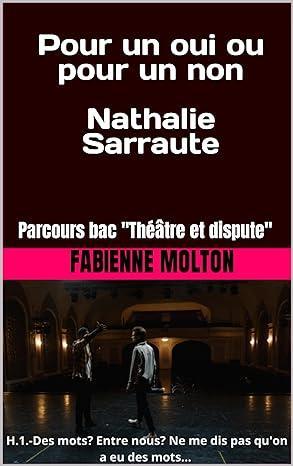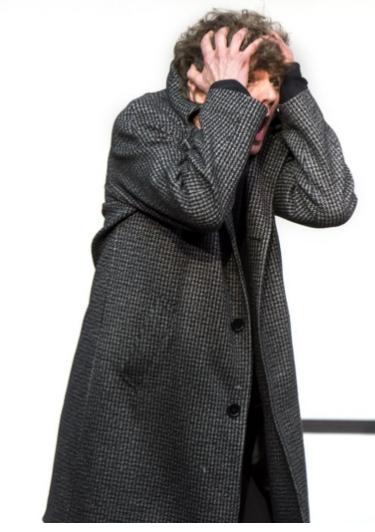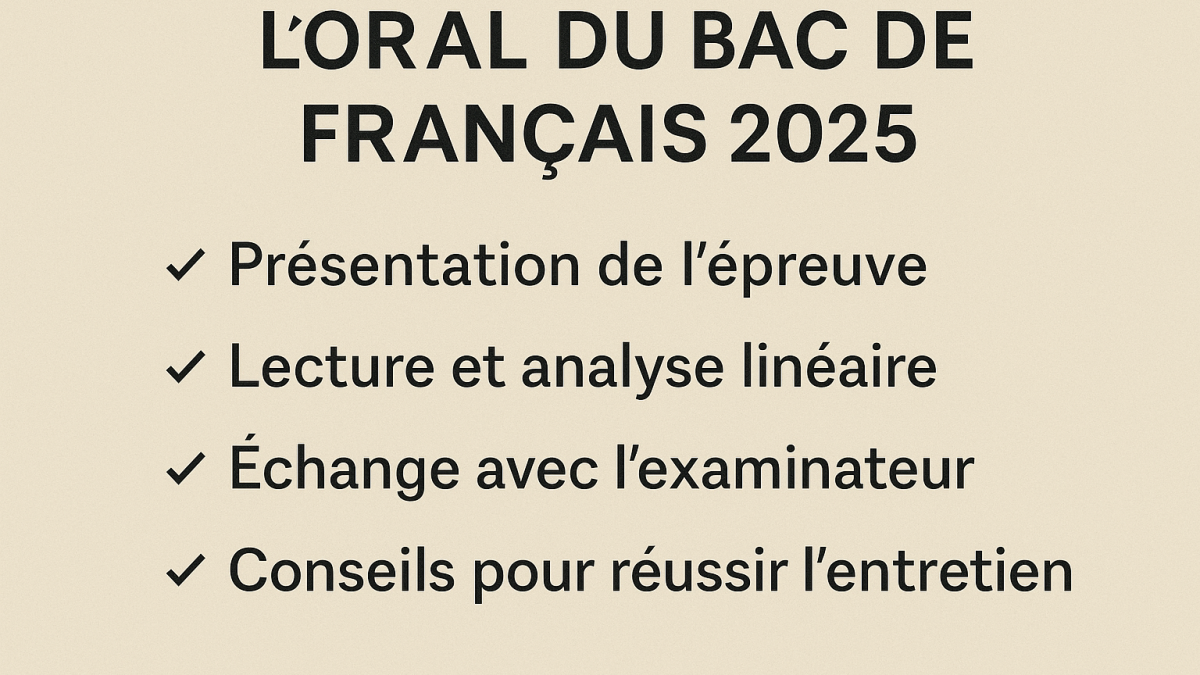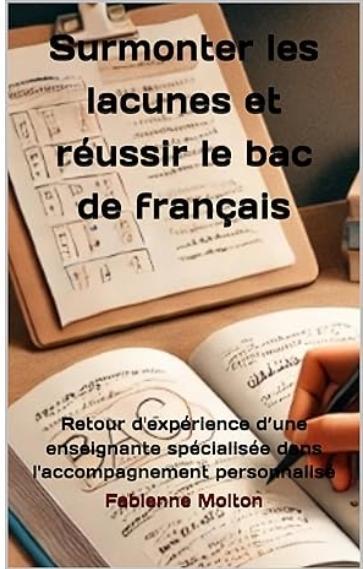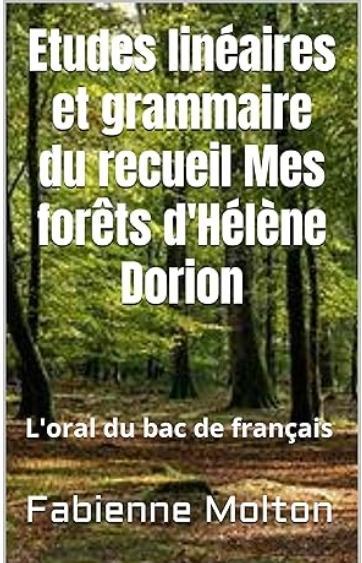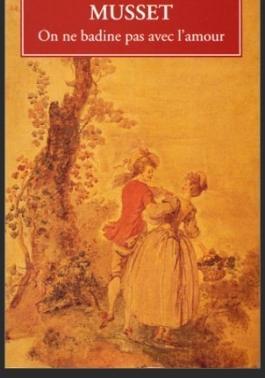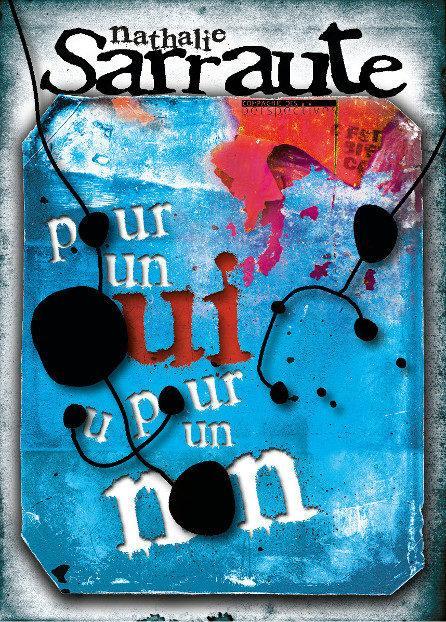
Qui est Nathalie Sarraute?
Nathalie Sarraute née le 18 juillet 1900 en Russie et morte en 1999 à Paris est une écrivaine et avocate, l'une des figures du Nouveau Roman.
Dès 1939, Nathalie Sarraute fait publier Tropismes ce qui vaut à son auteur d'être considérée à l'instar d'Alain Robbe-Grillet, de Michel Butor et de Claude Simon comme un écrivain du Nouveau Roman.
Influencée par Marcel Proust, James Joyce et Virginia Woolf, elle rejette les conventions traditionnelles du roman héritées du réalisme avec Balzac, Stendhal et du naturalisme avec Zola, Maupassant, pour analyser dans Tropismes les imperceptibles réactions physiques, spontanées que suscitent les règles sociales et langagières.
"Mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de la conscience ; ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir".
Pour un oui ou pour un non est une pièce de théâtre de Nathalie Sarraute, créée comme pièce radiophonique en décembre 1981, publiée en 1982 et représentée pour la première fois au théâtre en 1986.
C'est la pièce la plus jouée de Nathalie Sarraute, avec plus de 600 représentations professionnelles depuis sa création.
Comment résumer la pièce?
Écrite en 1981, Pour un oui ou pour un non est la sixième pièce de théâtre de Nathalie Sarraute. Œuvre d’abord radiophonique, elle met en scène un échange entre deux hommes, deux amis, appelés sobrement H1 et H2. Au cœur d’un dispositif scénique très dépouillé, ils tentent de mettre à nu et de comprendre le petit rien venu gripper leur longue amitié. De mots en mots, de tâtonnements en tâtonnements, et devant H3 et F venus figurer pour un moment le tribunal des gens de bon sens, leurs rancœurs affleurent, macèrent, cristallisent et se durcissent.
De la conversation à la sous-conversation
Les personnages comme support du langage
Pour un oui ou pour un non met en scène quatre personnages, sans noms : H1, H2, H3, et F. H : signifiant homme, et F: signifiant femme. La pièce dévoile des entités indéfinies, pas d'identité, pas de personnalité. Simple support du langage, les personnages se disputent sur une scène vide, épurée, au décor absent pour valoriser la parole dans une pièce dont l'intrigue ne porte que sur la parole.
"C'est bien, ça"
Au cours d'une conversation entre deux amis, H1 et H2, l'un complimente l'autre en prononçant les mots « C'est bien, ça ».
La conversation devient alors un débat, puis un conflit, en se développant autour de l'interprétation de cette formule, trois mots dérisoires, du ton sur lequel elle a été prononcée et de ses connotations plus ou moins implicites. La phrase anodine se charge de tropismes, d'interprétations, de jugements et met l'amitié des deux hommes en péril.
Tout le drame de cette pièce tient en trois mots, une petite phrase bien banale chargée de connotations qui est au coeur de l'intrigue. Les phrases d'apparence anodine sont interprétées dans le but d'en extraire le sens caché de chaque mot, les malentendus les plus implicites, les silences les plus révélateurs. Ces sous-entendus à l'origine du duel verbal intensifient la violence du conflit.
Une écriture fragmentée
Une écriture liée à l'affectivité qui peine à définir
Des points de suspension (aposiopèses) pour accueilir les non-dits, mettre en avant les mots qui se perdent dans des phrases inachevées sont caractéristiques de la ponctuation de Nathalie Sarraute.
L'aposiopèse
Définition : suspension du discours au moyen du signe de ponctuation
Dans la petite phrase à l'origine du conflit, l'intervalle entre "c'est bien" et "ça" est marqué par les points de suspension, il traduit un temps, un étirement, un allongement.
⦁ H2. Soupire - Pas tout à fait ainsi... il y avait entre "C'est bien" et "ça" un intervalle plus grand : "C'est biiien.... ça". Un accent mis sur "bien".... un étirement : "biiien..." et un suspens avant que "ça" arrive... ce n'est pas sans importance...
Tirets, deux points, points de suspension sont à l'image d'une écriture fragmentée enrichie par le fréquent recours à l'indéfini, "quelque chose", "rien", "on", pour traduire la fragmentation encore renforcée par le recours aux énumérations.
Une mise en scène de l'incommunicabilité en épanorthoses, de nombreuses phrases juxtaposées sans connecteur logique, des interrogations, des négations, un langage parlé, l'efficacité de parole sarrautienne est remise en question.
Analyse de Pour un oui ou pour un non
1. Présentation de l’œuvre
- Auteur : Nathalie Sarraute (1900-1999), figure majeure du Nouveau Roman et de la littérature d’exploration psychologique.
- Genre : pièce de théâtre courte (1963), pièce en prose, sans décor ni action visible, centrée sur le langage et les non-dits.
- Thématique générale : la violence des relations humaines à travers des échanges verbaux apparemment anodins.
- Place au bac : œuvre représentative du théâtre moderne qui déstructure le dialogue traditionnel pour montrer l’invisible tension entre les personnages.
2. Résumé synthétique
- La pièce met en scène deux personnages, Pierre et Bérengère, dont la relation amicale se détériore progressivement à cause de petites remarques, insinuations, et malentendus.
- Ces détails, dits “pour un oui ou pour un non”, finissent par provoquer un conflit profond.
- Les deux personnages révèlent par leurs échanges la violence psychologique et la fragilité des rapports humains.
3. Problématique
- Comment Sarraute utilise-t-elle le langage et les silences pour mettre en lumière la violence insidieuse des relations humaines ?
4. Axes d’analyse
A. Le langage comme théâtre de la violence invisible
- Le texte s’appuie sur des dialogues fragmentés, interrompus, et redondants.
- Les petites phrases anodines, répétées, deviennent des armes. Le langage cesse d’être un simple moyen de communication pour devenir un outil d’attaque ou de défense.
- Sarraute parle de “tropismes” : ces réactions psychologiques inconscientes qui trahissent des ressentis profonds.
- Cette violence est subtile, non dite explicitement, mais palpable dans la tension sous-jacente.
B. Le non-dit et les silences
- Beaucoup de ce qui compte dans la pièce ne se dit pas clairement, mais se devine entre les lignes.
- Les silences, hésitations, changements de ton révèlent les doutes, rancunes, blessures.
- Le spectateur/lecteur est invité à lire entre les mots, à percevoir l’invisible, ce qui est au cœur de la psychologie sarrautienne.
C. La fragilité des relations humaines
- La pièce montre à quel point les relations sont vulnérables, fragiles, souvent brisées par des malentendus ou des interprétations erronées.
- Pierre et Bérengère, anciennement amis, deviennent ennemis à cause d’une escalade de petites paroles blessantes.
- Sarraute critique ainsi la superficialité et la complexité paradoxale de la communication humaine.
5. Procédés littéraires
- Fragmentation du discours : phrases courtes, interruptions, anaphores, répétitions.
- Registre réaliste et psychologique : dialogue anodin en surface mais révélateur de conflits profonds.
- Absence d’intrigue extérieure : tout se joue dans la parole, rendant la pièce très intimiste.
- Style indirect libre dans certains passages pour exprimer les pensées non dites.
6. Portée de l’œuvre
- Sarraute renouvelle la forme théâtrale en privilégiant la psychologie et le langage sur l’action.
- Pour un oui ou pour un non interroge notre manière de communiquer, montrant que ce que l’on dit, ce que l’on tait, et comment on le dit, peut blesser profondément.
- La pièce révèle la complexité et la cruauté souvent cachées derrière les échanges humains quotidiens.
Conclusion
Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute met en scène la violence psychologique à travers un langage apparemment anodin mais chargé de sous-entendus et de non-dits. La pièce déconstruit le dialogue traditionnel pour dévoiler la fragilité et la brutalité des relations humaines. Par cette œuvre, Sarraute invite à une réflexion sur la parole, ses usages et ses limites, faisant du théâtre un miroir des tensions invisibles de la vie sociale.
« Théâtre et dispute »
1. La dispute comme moteur dramatique
- Dans Pour un oui ou pour un non, la dispute entre Pierre et Bérengère est le cœur de la pièce.
- La pièce repose uniquement sur leurs échanges verbaux, qui traduisent une tension croissante.
- Cette dispute n’est pas une simple querelle extérieure, mais un affrontement psychologique subtil où chaque mot, chaque inflexion porte un poids conflictuel.
2. Une dispute moderne et psychologique
- Contrairement au théâtre classique où la dispute suit souvent une logique rationnelle et ordonnée, ici la dispute est fragmentée, faite de sous-entendus, de silences, et de petites phrases blessantes.
- Sarraute explore la violence invisible des relations humaines : les conflits ne sont pas forcément éclatants mais profondément destructeurs.
- Cette dispute dévoile la complexité des sentiments, mêlant rancune, jalousie, douleur et incompréhension.
3. La parole comme arme
- Le langage devient une arme dans le combat entre Pierre et Bérengère.
- Chaque réplique est à double tranchant : elle cherche à blesser autant qu’à se défendre.
- Sarraute montre que dans le théâtre contemporain, la dispute peut se jouer dans la sphère du psychisme plus que dans l’action visible.
4. Une dispute sans résolution
- La pièce ne propose pas de réconciliation claire ni de résolution finale, ce qui renforce l’idée d’une dispute sans fin, caractéristique des conflits humains modernes.
- Cette absence de dénouement souligne la difficulté de communication et la fragilité des liens humains.
Conclusion
Ainsi, Pour un oui ou pour un non illustre parfaitement le parcours « Théâtre et dispute » en proposant une dispute théâtrale nouvelle, psychologique et fragmentée, où la parole révèle autant qu’elle blesse. Sarraute renouvelle le genre en montrant que la dispute peut être un combat intérieur, une tension invisible mais puissante, qui rend compte de la complexité des rapports humains.