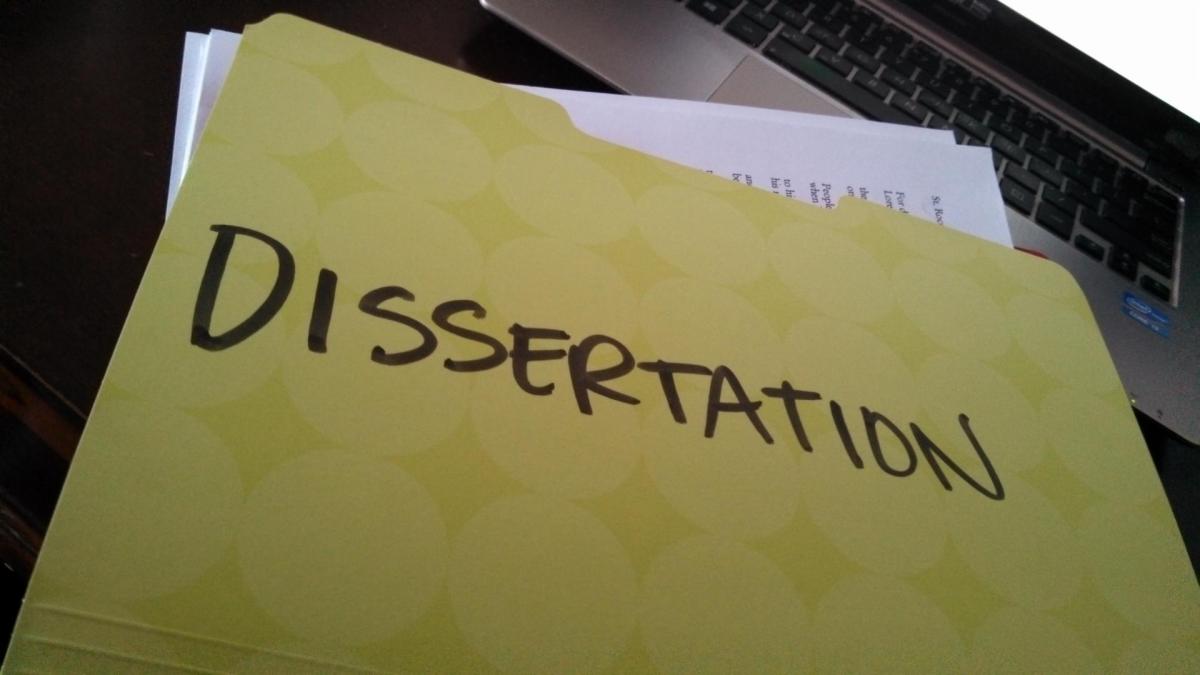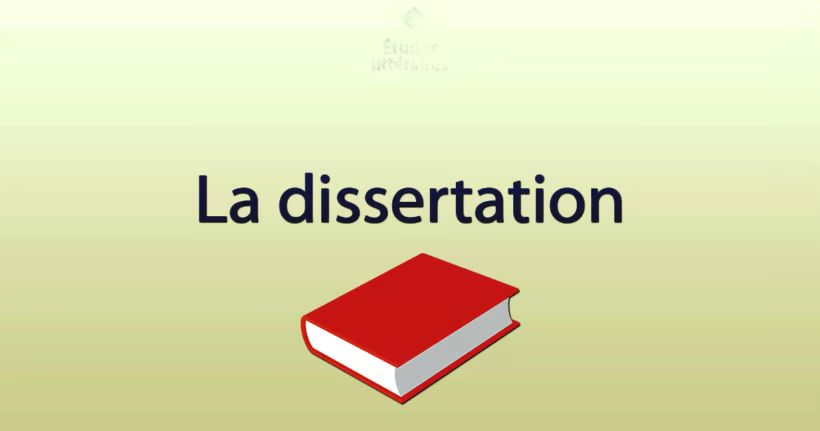Sujet :
Sujet :
Dans Lettres d’une Péruvienne (1747), Françoise de Graffigny met en scène Zilia, une jeune femme arrachée à son monde d’origine, contrainte de découvrir les mœurs d’un univers étranger. Ce roman épistolaire permet-il non seulement de décrire un nouvel univers, mais aussi de questionner sa propre société ?
Ce sujet ouvre à un développement en trois axes possibles :
- La découverte d’un univers nouveau : le roman montre l’étonnement de Zilia devant les différences de coutumes, de langage, de rapports sociaux et politiques.
- La critique implicite de la société française : le regard naïf et étranger de Zilia permet de mettre en lumière les incohérences, injustices ou absurdités des pratiques européennes.
- L’enrichissement du lecteur : en suivant ce double décentrement, le lecteur est invité à s’interroger sur sa propre culture et à élargir son horizon
Fiche méthode
1. Introduction express (≈ 8-10 lignes)
- Accroche : XVIIIᵉ siècle = curiosité pour l’ailleurs, voyages réels ou fictifs.
- Présentation de l’œuvre : Lettres d’une Péruvienne, 1747, roman épistolaire → Zilia, Péruvienne enlevée, découvre la société française.
- Problématique : Ce roman se limite-t-il à peindre un univers exotique ou bien permet-il de réfléchir à notre propre société ?
- Annonce de plan : Découverte → Critique → Enrichissement du lecteur.
2. Développement (3 parties – transitions fluides)
I. Découverte d’un univers nouveau
- Langue étrangère → arbitraire du langage.
- Mœurs françaises → étonnement, dépaysement.
- Relativité des valeurs → Pérou ≠ France.
Transition : Mais derrière cet étonnement, se cache une critique implicite.
II. Critique de la société française
- Inégalités sociales → absurdité des privilèges.
- Condition féminine → dépendance, mariage = servitude.
- Religion → contradictions, intolérance.
Transition : Cette critique ne vise pas seulement à dénoncer : elle éduque le lecteur.
III. Enrichissement du lecteur
- Décentrement → relativiser ses propres valeurs.
- Élargissement d’horizon → fiction = voyage.
- Appel au progrès → réformer, émanciper, esprit des Lumières.
3. Conclusion (≈ 6-7 lignes)
- Bilan : double rôle = dépaysement + critique sociale.
- Réponse à la problématique : le roman permet à la fois de découvrir et de réfléchir.
- Ouverture : Montesquieu, Lettres persanes → même procédé critique, mais voix masculine ; Graffigny apporte une voix féminine.
4. Astuces de rédaction rapide
- Utilise des connecteurs logiques : d’abord, ensuite, enfin / mais, or, ainsi.
- Cites au moins 2 passages précis : Zilia étonnée par la langue, Zilia critiquant la condition féminine.
- Mets en valeur le lien avec le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux ».
- Soigne la 1re phrase (accroche) et la dernière (ouverture) → ça fait toujours bonne impression.
 Sujet :
Sujet :
Dans Lettres d’une Péruvienne (1747), Françoise de Graffigny met en scène Zilia, une jeune femme arrachée à son monde d’origine, contrainte de découvrir les mœurs d’un univers étranger. Ce roman épistolaire permet-il non seulement de décrire un nouvel univers, mais aussi de questionner sa propre société ?
Au XVIIIᵉ siècle, les récits de voyage et les romans épistolaires connaissent un grand succès : ils ouvrent au lecteur européen une fenêtre sur des horizons nouveaux, réels ou imaginaires. Dans Lettres d’une Péruvienne, Françoise de Graffigny invente une héroïne arrachée au Pérou et confrontée à la société française. Par son regard naïf, Zilia découvre un univers radicalement différent du sien et met en lumière, avec étonnement ou incompréhension, des pratiques que les Européens considèrent comme naturelles. Ce roman épistolaire, en donnant voix à une étrangère, ne se contente pas de décrire un monde nouveau : il invite aussi à réfléchir sur les valeurs et les contradictions de la société française du XVIIIᵉ siècle.
Problématique : Dans quelle mesure Lettres d’une Péruvienne est-il à la fois récit de découverte et outil critique qui interroge notre propre univers ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que le roman offre la peinture vivante d’un nouvel univers à travers le regard de Zilia (I), puis qu’il constitue un moyen de critique sociale et politique de la France (II), enfin qu’il invite le lecteur à un élargissement de sa vision du monde et à une réflexion sur soi-même (III).
I. Un nouvel univers offert au regard d’une étrangère
1. L’étonnement devant la langue et la communication
Zilia doit apprendre à communiquer dans un idiome inconnu. La barrière linguistique crée d’abord un sentiment d’étrangeté et met en relief le rôle du langage comme vecteur culturel. En découvrant la langue française, elle découvre en même temps une vision du monde différente. Cet apprentissage permet au lecteur de prendre conscience de l’arbitraire du langage, qu’il a tendance à considérer comme naturel.
2. Les mœurs et coutumes nouvelles
Zilia observe avec curiosité et perplexité les pratiques françaises, par exemple les usages mondains, les manières de table ou la liberté des femmes dans les salons. Ces descriptions, à la fois réalistes et parfois satiriques, plongent le lecteur dans un univers exotique, celui de la France vue de l’extérieur. Ce dépaysement rend visible ce qui d’ordinaire reste invisible, tant il est intégré.
3. La confrontation entre deux conceptions du monde
Le contraste entre la culture péruvienne et la culture française fait apparaître la relativité des valeurs : ce qui paraît naturel aux Européens choque Zilia, et inversement. L’univers nouveau ne se réduit pas à un décor exotique : il devient un miroir qui révèle que toute civilisation est une construction humaine.
II. Une critique implicite de la société française
1. La dénonciation des inégalités sociales
À travers le regard de Zilia, les injustices entre riches et pauvres apparaissent comme absurdes. Elle s’étonne que certains vivent dans l’opulence alors que d’autres manquent du nécessaire. En soulignant cette disproportion, Graffigny fait percevoir la France de l’Ancien Régime comme fondée sur une hiérarchie arbitraire.
2. La condition féminine remise en cause
Zilia remarque avec étonnement la dépendance des femmes françaises vis-à-vis des hommes, notamment dans le mariage. Elle compare leur situation à une forme d’asservissement, ce qui traduit la sensibilité pré-féministe de Graffigny. Ainsi, le roman devient une critique implicite du patriarcat et des contraintes imposées aux femmes au XVIIIᵉ siècle.
3. Une remise en question de la religion et des croyances
Zilia s’interroge sur les pratiques religieuses européennes, qui lui paraissent étranges ou contradictoires. Son regard met en évidence les excès de l’intolérance et les rites figés de l’Église. Ce décentrement sert à Graffigny à ébranler la vision dogmatique de ses contemporains et à ouvrir la voie à une réflexion éclairée, proche de celle des philosophes des Lumières.
III. Un enrichissement intellectuel et moral pour le lecteur
1. Le décentrement comme outil de réflexion
En adoptant le regard d’une étrangère, le lecteur découvre qu’il n’existe pas de norme universelle. Cette prise de recul conduit à une relativisation salutaire de sa propre culture : ce qui est « naturel » ou « évident » n’est qu’une construction sociale.
2. L’élargissement de l’horizon grâce à la fiction
Même si Zilia est un personnage fictif, son expérience de l’altérité a une valeur universelle. Le lecteur vit à travers elle une expérience de voyage et d’étrangeté. Ainsi, le roman réalise pleinement le projet du parcours : « un nouvel univers s’est offert à mes yeux ».
3. Un appel à la réforme et au progrès
Au-delà du dépaysement, Graffigny invite implicitement le lecteur à transformer son regard sur le monde. La critique de l’injustice, de l’inégalité et de l’oppression féminine n’a pas pour seule fonction de divertir, mais bien de préparer une société meilleure. Le roman épistolaire devient alors un outil d’émancipation intellectuelle et morale.
En somme, Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny permet au lecteur d’explorer un univers étranger à travers les yeux de Zilia (I), mais aussi de mettre en question la société française du XVIIIᵉ siècle par un effet de miroir critique (II). Ce double mouvement, entre dépaysement et réflexion, élargit l’horizon intellectuel et moral du lecteur (III). L’œuvre illustre ainsi parfaitement le thème du parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux ».
Ouverture : On peut rapprocher cette démarche de celle de Montesquieu dans Les Lettres persanes, où le regard des Persans sur la France permet, là aussi, d’allier exotisme et critique des mœurs européennes.
Dissertation rédigée
Au XVIIIᵉ siècle, les lecteurs européens s’enthousiasment pour les récits de voyage et les romans qui ouvrent la porte à des horizons nouveaux. La curiosité pour l’exotisme se mêle à une réflexion critique, caractéristique du siècle des Lumières. Françoise de Graffigny, avec son roman épistolaire Lettres d’une Péruvienne publié en 1747, imagine une héroïne, Zilia, enlevée de son pays natal et contrainte de découvrir la société française. À travers ses lettres, cette étrangère observe avec étonnement un univers radicalement différent du sien. Mais le récit ne se contente pas de peindre un décor exotique : il amène à questionner les fondements de la civilisation européenne.
Dès lors, on peut se demander : dans quelle mesure ce roman épistolaire permet-il à la fois de décrire un univers nouveau et de mettre en question sa propre société ?
Nous verrons d’abord que Lettres d’une Péruvienne plonge le lecteur dans le regard émerveillé et étonné d’une étrangère découvrant un nouveau monde (I), puis qu’il constitue une critique implicite et parfois sévère de la société française (II), avant de montrer qu’il invite le lecteur à élargir sa vision du monde et à réfléchir à sa propre condition (III).
I. Un nouvel univers offert au regard d’une étrangère
D’abord, le roman séduit par la peinture vivante d’un univers inédit.
En premier lieu, la découverte de la langue française par Zilia suscite un véritable étonnement. Elle souligne la difficulté de se faire comprendre et perçoit combien les mots ne traduisent pas toujours fidèlement la pensée. Cette barrière linguistique permet à Graffigny de montrer que le langage n’est pas un outil universel, mais un code arbitraire qui structure la pensée. Ainsi, à travers le personnage de Zilia, le lecteur prend conscience de l’importance culturelle des mots.
En second lieu, Zilia découvre les mœurs françaises, qu’elle décrit avec curiosité et perplexité. Les usages de table, les conventions sociales, les règles de politesse ou encore l’obsession des femmes pour la mode et les apparences lui semblent étranges, parfois ridicules. Ces observations réalistes produisent un effet de dépaysement : le lecteur voit sa propre culture à travers un miroir étranger. C’est comme si le quotidien le plus banal devenait digne d’étonnement.
Enfin, la confrontation entre la culture péruvienne et la culture française met en évidence la relativité des valeurs. Ce qui paraît naturel aux Européens choque Zilia ; inversement, ce qu’elle juge essentiel paraît superflu aux Français. Par ce contraste, Graffigny révèle que les civilisations reposent sur des choix arbitraires et non sur une vérité universelle. Ainsi, l’univers étranger n’est pas seulement un décor exotique, mais un révélateur de la diversité humaine.
Transition : Ce regard dépaysé n’est pourtant pas neutre. Derrière l’étonnement de Zilia, Graffigny glisse une critique des travers de la société française.
II. Une critique implicite de la société française
Le roman prend alors la forme d’une satire subtile, qui dénonce les injustices de la société européenne.
Tout d’abord, Zilia perçoit avec stupeur les inégalités sociales qui divisent la France. Elle s’étonne que certains vivent dans l’abondance alors que d’autres manquent du nécessaire. Ce contraste, qu’elle juge arbitraire, met en lumière les fondements inéquitables de l’Ancien Régime. Son regard étranger dévoile ce que les contemporains avaient tendance à accepter comme une évidence : l’existence de privilèges scandaleux.
Ensuite, le roman critique la condition féminine. Zilia constate que les femmes françaises, malgré leur raffinement apparent, dépendent totalement des hommes, en particulier dans le mariage. Elle compare leur situation à une forme d’asservissement, où la liberté est sacrifiée au profit des convenances sociales. Par cette voix féminine étrangère, Graffigny fait entendre une revendication inédite pour l’époque, annonçant déjà les débats sur l’émancipation des femmes.
Enfin, le regard critique de Zilia s’étend aux pratiques religieuses. Elle souligne les contradictions d’une religion qui prêche l’amour mais tolère l’intolérance et l’exclusion. Ses remarques rappellent les interrogations des philosophes des Lumières, qui cherchaient à réformer l’Église et à promouvoir une foi plus rationnelle. Ainsi, Graffigny utilise l’étonnement de son héroïne pour ébranler les certitudes dogmatiques de ses lecteurs.
Transition : Ce roman, qui alterne découverte et critique, ne se réduit pas à une simple satire. Il propose au lecteur une véritable expérience intellectuelle et morale.
III. Un enrichissement intellectuel et moral pour le lecteur
Enfin, Lettres d’une Péruvienne dépasse le simple cadre narratif pour transformer la vision du lecteur.
En premier lieu, le procédé du décentrement force le lecteur à réfléchir sur sa propre culture. En adoptant le regard naïf de Zilia, il comprend que ses coutumes ne sont ni naturelles ni universelles, mais relatives. Cette relativisation a une valeur philosophique : elle invite à interroger ce qui est présenté comme évident.
En deuxième lieu, la fiction permet un véritable élargissement de l’horizon. Bien que Zilia soit un personnage imaginaire, sa découverte du monde français a la force d’un récit de voyage authentique. Le lecteur vit par procuration une expérience de l’altérité et réalise le projet du parcours : « un nouvel univers s’est offert à mes yeux ».
Enfin, le roman se fait appel à la réforme et au progrès. La critique des inégalités sociales, de l’oppression des femmes ou des rigidités religieuses n’a pas pour seul but de divertir : elle engage le lecteur à envisager une société plus juste et plus humaine. Le roman épistolaire devient ainsi un outil d’émancipation intellectuelle, en accord avec l’esprit des Lumières.
En définitive, Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny accomplit un double rôle. Par le regard dépaysé de Zilia, il offre au lecteur la découverte d’un univers nouveau, où chaque détail du quotidien devient matière à étonnement (I). Mais il est aussi une critique implicite de la société française, dénonçant inégalités, injustices et condition féminine (II). Enfin, il ouvre au lecteur une réflexion plus large sur la relativité des valeurs et sur la possibilité d’un progrès moral et social (III).
Ce roman illustre parfaitement le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux », puisqu’il conjugue le plaisir du dépaysement et la profondeur de la critique.
Ouverture : Cette démarche n’est pas isolée : Montesquieu, dans Les Lettres persanes (1721), avait déjà utilisé le regard fictif d’étrangers pour inviter les lecteurs à s’interroger sur leurs propres institutions. Graffigny s’inscrit ainsi dans la même lignée, tout en donnant la parole, fait rare à l’époque, à une héroïne féminine.
Disserter sur Françoise de Graffigny
Lettres d'une Péruvienne
A mettre en lien :
En définitive, Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny illustre bien l’ambivalence du roman épistolaire : à travers la voix de Zilia, il permet à la fois l’expression d’une expérience intime – celle de l’arrachement, de l’exil et des tourments amoureux – et la critique de la société française du XVIIIᵉ siècle, en particulier de la condition féminine. Cette double fonction, entre confession et dénonciation, fait de l’œuvre une contribution essentielle au projet des Lumières, où l’écriture devient un instrument de réflexion et d’émancipation.
On peut rapprocher cette démarche de celle de Montesquieu dans les Lettres persanes, qui recourait déjà au regard étranger pour interroger les travers de la société française, mais aussi de Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, où la lettre se fait avant tout le lieu de l’expression des émotions intimes. Ainsi, Graffigny réussit à combiner ces deux traditions, en offrant à la fois un roman du sentiment et un texte de combat pour l’égalité.
Montesquieu, Lettres persanes (1721)
Deux Persans découvrent la société française → critique des mœurs et des institutions à travers le regard étranger.
C’est le parallèle le plus direct avec Graffigny : même forme, même décentrement culturel.
Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761)
Roman épistolaire centré sur la confession intime et les émotions.
Permet de montrer que l’épistolaire est aussi un lieu d’analyse sentimentale, pas seulement critique.


 Sujet 1 :
Sujet 1 :