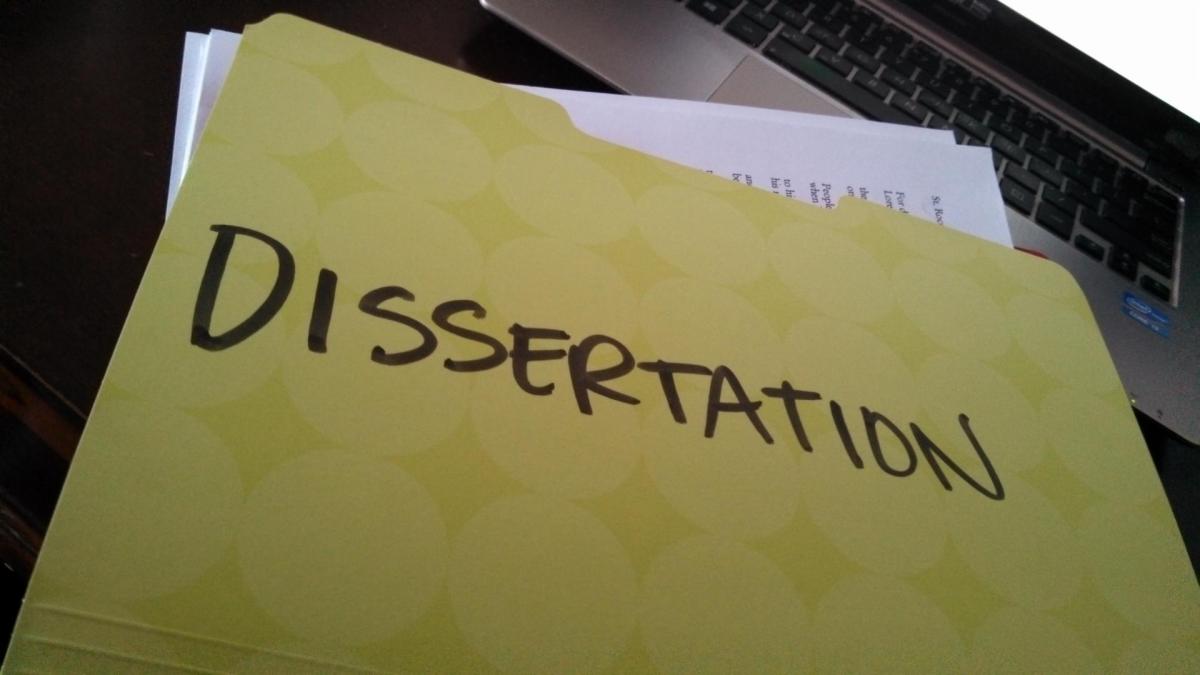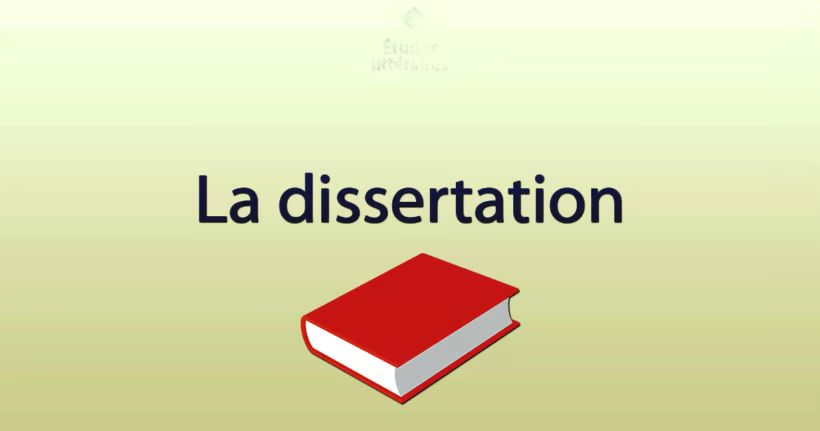Sujet
Sujet
La découverte d’un univers étranger dans le roman épistolaire, Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny, permet-elle de renouveler le regard porté sur sa propre société ?
Ce sujet te permettrait de travailler à la fois :
- la découverte de l’autre et du « nouvel univers » (Zilia arrachée au Pérou découvre l’Europe),
- le regard critique porté sur la France à travers les yeux d’une étrangère,
- mais aussi la réflexion sur l’identité, la liberté et la condition féminine au XVIIIᵉ siècle.
Au XVIIIᵉ siècle, le roman épistolaire connaît un grand succès en Europe : il met en scène des personnages qui découvrent des mondes nouveaux, réels ou imaginaires, et s’expriment à travers des lettres qui laissent entendre leur étonnement, leur sensibilité et leurs jugements. Dans Lettres d’une Péruvienne (1747), Françoise de Graffigny donne la parole à Zilia, une princesse inca arrachée à son pays, confrontée aux mœurs françaises. Ce dépaysement produit un double effet : d’une part, un dévoilement intime de l’expérience vécue par une étrangère ; d’autre part, une critique implicite des institutions, des coutumes et des inégalités de la société française. On peut alors se demander : dans quelle mesure la découverte d’un univers étranger dans le roman épistolaire permet-elle de renouveler le regard porté sur sa propre société ?
I – L’étranger comme expérience intime et sensible
1. La lettre, espace d’une confession personnelle
Dans Lettres d’une Péruvienne, Zilia exprime librement sa détresse, ses espoirs et ses émotions (séparation d’Aza, solitude, incompréhension des coutumes françaises).
L’écriture épistolaire fonctionne comme une thérapie, où l’étrangère confie ce qu’elle ne peut dire à haute voix dans son nouvel environnement.
Ce procédé permet au lecteur d’accéder directement à une subjectivité féminine rarement entendue au XVIIIᵉ siècle.
2. La découverte d’un univers nouveau comme mise en crise de soi
Le contraste brutal entre le Pérou et la France oblige Zilia à interroger son identité, ses valeurs et ses repères.
Elle passe de l’univers ritualisé et hiérarchisé des Incas à une société mondaine gouvernée par l’argent et le rang.
Le dépaysement fonctionne comme un révélateur intérieur : le « nouvel univers » dévoile à la fois l’altérité et la fragilité de ses propres certitudes.
3. Une ouverture sur l’universel par l’expérience particulière
La confession intime ne reste pas enfermée dans l’individuel : l’expérience de Zilia touche tout lecteur qui a déjà connu l’épreuve de l’étrangeté.
La fiction permet donc de transformer une situation singulière (une Péruvienne en France) en une réflexion universelle sur l’identité et l’adaptation.
De la même façon, dans Lettres persanes, Montesquieu fait des émotions et étonnements de Rica et Usbek un miroir universel de la confrontation entre Orient et Occident.
II – L’étranger comme révélateur des travers de la société d’accueil
1. Un regard neuf qui dénaturalise les coutumes
Zilia observe la société française comme un entomologiste, décrivant ses rites avec un étonnement qui souligne leur absurdité (par ex. les fêtes frivoles, la galanterie superficielle).
En rendant étranges des pratiques considérées comme normales, elle invite le lecteur à les remettre en question.
Même procédé chez Montesquieu : Rica, découvrant la mode française ou la justice, montre par l’absurde ce qui semblait naturel aux contemporains.
2. La critique des inégalités et des injustices
Zilia dénonce les inégalités sociales, le rôle subalterne des femmes, la domination de l’argent et la corruption des mœurs.
Cette critique est d’autant plus percutante qu’elle vient d’une étrangère qui ne comprend pas la légitimité de ces hiérarchies.
Montesquieu, à travers Usbek, dénonce aussi le despotisme, l’arbitraire religieux ou la frivolité des salons, révélant par contraste la nécessité de la tolérance et de la justice.
3. La force persuasive d’une voix extérieure
L’étrangère, précisément parce qu’elle n’est pas intégrée, peut se permettre un regard libre.
L’effet de distanciation rend la critique moins polémique : il ne s’agit pas d’un réquisitoire direct, mais d’un constat « naïf ».
Ce décalage crée un effet de satire douce et efficace, qui amène le lecteur à sourire, puis à réfléchir.
III – Le roman épistolaire comme laboratoire d’un nouvel humanisme
1. Une redéfinition de la place de la femme
Graffigny utilise Zilia pour revendiquer la liberté intellectuelle et morale des femmes : l’éducation, l’indépendance, la capacité à juger.
Le dépaysement lui permet de dénoncer subtilement la condition féminine en France.
Ainsi, la découverte de l’autre univers devient l’occasion d’affirmer une exigence d’égalité.
2. L’ouverture au relativisme culturel et philosophique
Le roman épistolaire fondé sur l’altérité enseigne que nos coutumes ne sont pas universelles.
Ce relativisme prépare l’esprit des Lumières, qui valorise la comparaison des cultures pour mieux questionner les dogmes.
Lettres persanes illustre parfaitement cette leçon : en confrontant Orient et Occident, Montesquieu montre que toute société est relative.
3. L’émergence d’une pensée critique et réformatrice
Par la fiction d’un regard étranger, le roman épistolaire devient un outil de réforme sociale : il ne se contente pas de divertir, il instruit.
Il propose un idéal plus juste : une société de raison, de tolérance et d’équité.
La rencontre d’un « nouvel univers » nourrit donc une réflexion politique et morale qui participe de l’esprit des Lumières.
Ainsi, la découverte d’un univers étranger dans le roman épistolaire n’est pas un simple décor exotique : elle constitue une véritable stratégie narrative qui permet à la fois une confession intime (le lecteur partage l’épreuve d’une conscience étrangère) et une critique efficace de la société d’accueil (la France, dans le cas de Zilia). Par ce décalage fécond, Graffigny comme Montesquieu offrent au lecteur du XVIIIᵉ siècle un regard renouvelé sur ses propres coutumes et l’invitent à penser autrement son monde.
Le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » éclaire cette dynamique : c’est bien en confrontant son regard à celui d’autrui qu’on découvre non seulement l’autre, mais aussi soi-même.
 Le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » illustre la découverte d’un monde étranger par le protagoniste ou la narratrice. Dans Lettres d’une Péruvienne, Zilia, arrachée à son pays et plongée dans la société française, vit une confrontation permanente entre son univers d’origine et celui qu’elle découvre. Cette expérience de dépaysement lui permet de remettre en question les normes, coutumes et valeurs européennes, mais aussi de réfléchir à sa propre culture.
Le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux » illustre la découverte d’un monde étranger par le protagoniste ou la narratrice. Dans Lettres d’une Péruvienne, Zilia, arrachée à son pays et plongée dans la société française, vit une confrontation permanente entre son univers d’origine et celui qu’elle découvre. Cette expérience de dépaysement lui permet de remettre en question les normes, coutumes et valeurs européennes, mais aussi de réfléchir à sa propre culture.
Le sujet du bac, « la découverte d’un univers étranger dans le roman épistolaire permet-elle de renouveler le regard porté sur sa propre société ? », s’inscrit directement dans ce parcours. Le roman épistolaire offre une voix intime et subjective, où l’observation d’un monde nouveau devient un outil critique : à travers ses lettres, Zilia exprime ses émotions et ses impressions personnelles, tout en analysant les différences culturelles et les contradictions sociales. Ainsi, le roman ne se limite pas à une confession intérieure, il devient aussi un miroir de la société européenne, permettant au lecteur comme à la narratrice de voir sa propre société sous un angle inédit.
En résumé, le parcours montre que l’expérience d’un nouvel univers dans le roman épistolaire est à la fois une aventure personnelle et un moyen de critique sociale, ce qui rejoint pleinement la problématique du sujet.
Exemples d'ouvertures
- Ouverture 1
- Littérature : On peut élargir la réflexion au roman épistolaire moderne ou à la littérature de voyage, qui utilisent souvent la confrontation à un univers étranger pour susciter la réflexion critique sur soi et sur sa société, comme dans Lettres persanes de Montesquieu.
- Ouverture 2
- Philosophie : La découverte d’un monde nouveau invite à des réflexions philosophiques sur le relativisme culturel, la tolérance et le jugement critique. Elle montre que la confrontation à l’autre permet de repenser ses propres valeurs et normes, un questionnement que l’on retrouve dans la pensée des Lumières.
- Ouverture 3
- Candide de Voltaire : voyage et confrontation à différents univers pour critiquer la société européenne.
- Robinson Crusoé de Defoe : la rencontre avec un autre monde ou la nature permet une réflexion sur la civilisation et la société humaine.
- Ouverture 4
- Philosophie morale et politique
- Le relativisme culturel de Montaigne (Essais, « Des Cannibales ») ou la réflexion sur la tolérance chez Voltaire et Montesquieu : la découverte de l’autre stimule une pensée critique sur ses propres lois et coutumes.
Ouvertures intégrées / Modèle de conclusion
En somme, le roman épistolaire qui met en scène la découverte d’un univers étranger, comme dans les Lettres d’une Péruvienne de Graffigny, permet non seulement d’exprimer une expérience intime mais aussi d’ouvrir un espace critique : la voix de Zilia, confrontée à l’Europe, révèle à la fois les richesses de la différence et les travers d’une société qui se croit supérieure. À travers le regard de l’autre, c’est notre propre monde qui apparaît sous un jour neuf.
Ce procédé s’inscrit pleinement dans le parcours « Un nouvel univers s’est offert à mes yeux », où la rencontre avec l’altérité devient un moyen de renouveler sa perception de soi et de sa culture.
Ouvertures possibles :
- Voltaire, dans Candide, fait voyager son héros à travers le monde pour mieux pointer les contradictions et injustices de l’Europe.
- Montaigne, dans « Des Cannibales », utilisait déjà la comparaison avec les peuples du Nouveau Monde pour critiquer l’ethnocentrisme européen.
- Plus largement, la littérature de voyage et les récits anthropologiques mettent en lumière la relativité des coutumes et invitent à la tolérance.
- Au cinéma, des œuvres comme Avatar ou Le Dernier des Mohicans reposent sur le même principe : la découverte d’une culture étrangère révèle les failles et les violences de la nôtre.
- Enfin, dans le monde actuel, les migrations et les échanges culturels jouent ce rôle : ils nous obligent à repenser nos normes et à relativiser nos certitudes.
Autre modèle : Conclusion / Ouverture
Ainsi, à travers la voix de l’étranger, le roman épistolaire invite le lecteur à renouveler son regard sur le monde qui l’entoure et à en questionner les certitudes. Cette démarche ne se limite pas au XVIIIᵉ siècle : qu’il s’agisse de Montaigne dans ses Essais, de Voltaire dans Candide ou encore des récits de voyage modernes, la confrontation à l’altérité continue d’alimenter une réflexion sur la relativité des valeurs et sur la nécessité d’une tolérance universelle.
Disserter sur Françoise de Graffigny
Lettres d'une Péruvienne
A mettre en lien :
En définitive, Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny illustre bien l’ambivalence du roman épistolaire : à travers la voix de Zilia, il permet à la fois l’expression d’une expérience intime – celle de l’arrachement, de l’exil et des tourments amoureux – et la critique de la société française du XVIIIᵉ siècle, en particulier de la condition féminine. Cette double fonction, entre confession et dénonciation, fait de l’œuvre une contribution essentielle au projet des Lumières, où l’écriture devient un instrument de réflexion et d’émancipation.
On peut rapprocher cette démarche de celle de Montesquieu dans les Lettres persanes, qui recourait déjà au regard étranger pour interroger les travers de la société française, mais aussi de Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, où la lettre se fait avant tout le lieu de l’expression des émotions intimes. Ainsi, Graffigny réussit à combiner ces deux traditions, en offrant à la fois un roman du sentiment et un texte de combat pour l’égalité.
Montesquieu, Lettres persanes (1721)
Deux Persans découvrent la société française → critique des mœurs et des institutions à travers le regard étranger.
C’est le parallèle le plus direct avec Graffigny : même forme, même décentrement culturel.
Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761)
Roman épistolaire centré sur la confession intime et les émotions.
Permet de montrer que l’épistolaire est aussi un lieu d’analyse sentimentale, pas seulement critique.

 Sujet
Sujet  Sujet 1 :
Sujet 1 :