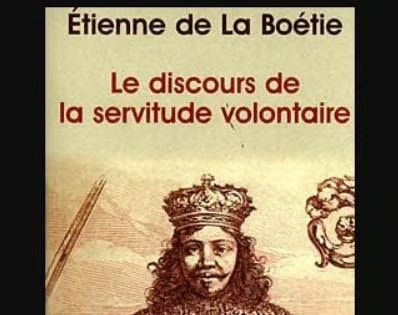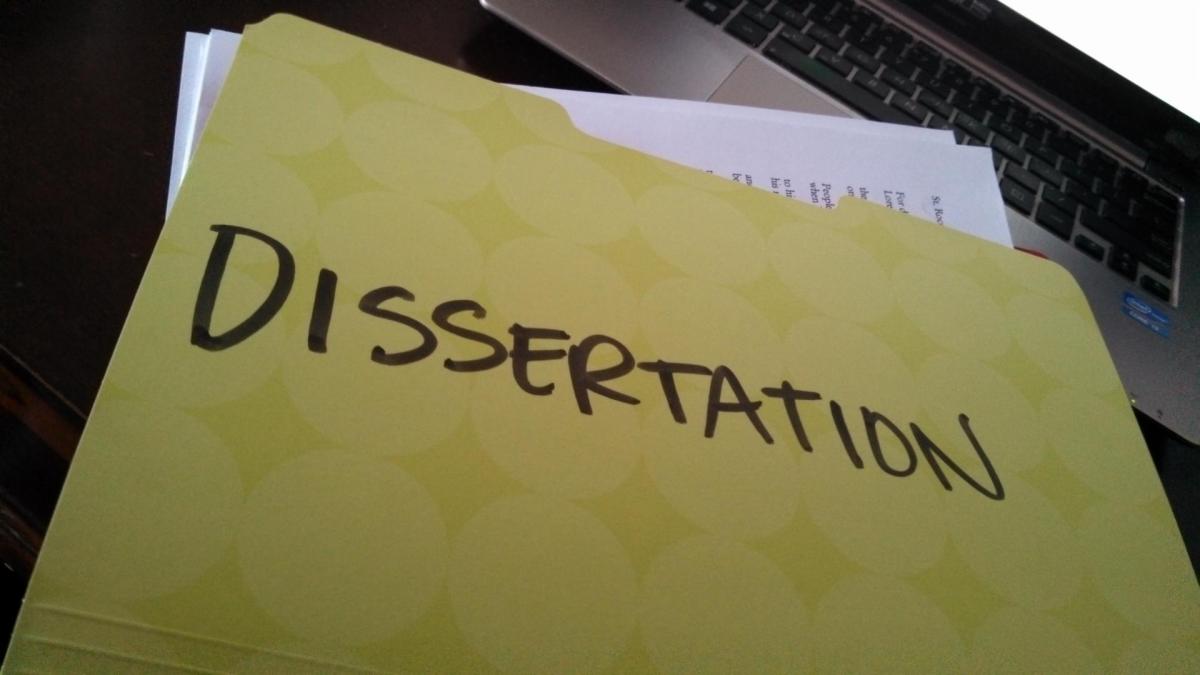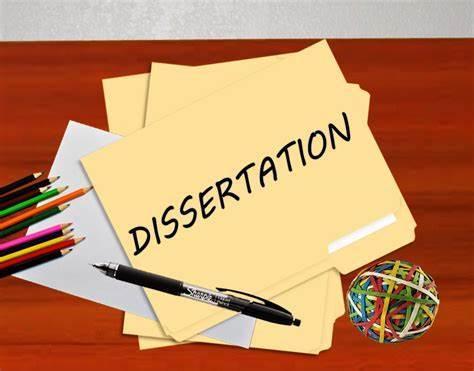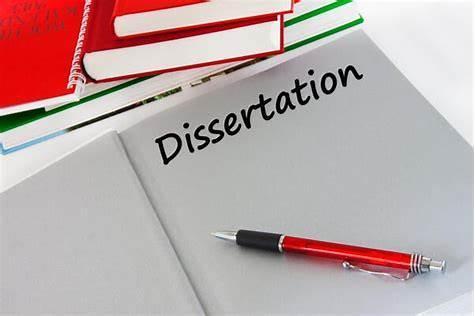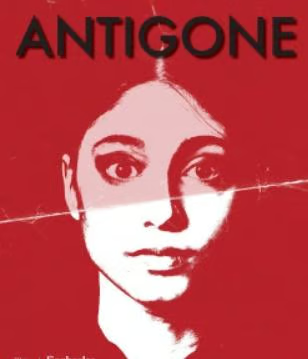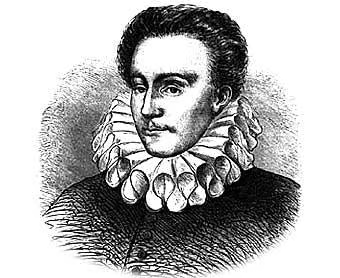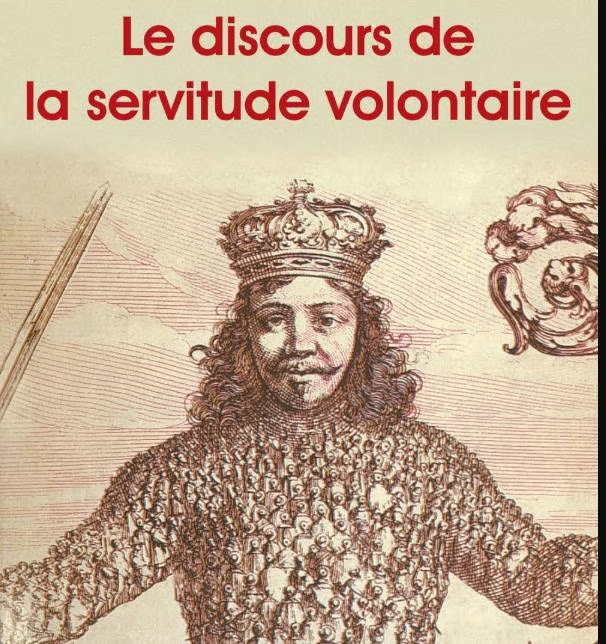Sujet :
La Boétie affirme que « les hommes se laissent asservir alors qu’ils pourraient vivre libres ». À la lumière du Discours de la servitude volontaire et des textes du parcours « Défendre et entretenir la liberté », penses-tu que la liberté soit un combat permanent ou un état naturel que l’homme risque toujours de perdre ?
Dès l’Antiquité, les philosophes et les moralistes se sont interrogés sur la condition humaine : l’homme est-il né libre, ou condamné à subir des formes de domination ? Dans son Discours de la servitude volontaire (vers 1549), Étienne de La Boétie formule une idée paradoxale et provocante : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres ». Autrement dit, si les hommes vivent sous la tyrannie, ce n’est pas à cause de la force du tyran, mais parce qu’ils acceptent eux-mêmes de se soumettre. Or, ce constat n’appartient pas seulement au XVIᵉ siècle : il résonne encore aujourd’hui, dans les luttes politiques, sociales et philosophiques autour de la liberté. Faut-il alors considérer la liberté comme un état naturel inscrit dans la condition humaine, que l’homme perd par négligence, ou bien comme un combat permanent, à recommencer sans cesse, pour résister aux forces qui menacent de l’abolir ?
Problématique : La liberté est-elle pour La Boétie un état naturel constitutif de l’homme, ou bien une conquête à renouveler sans cesse face au risque permanent de servitude ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que la liberté est pensée comme un état premier, inscrit dans la nature humaine. Nous montrerons ensuite que les hommes, par faiblesse ou habitude, s’exposent à la perdre et à accepter l’asservissement. Enfin, nous soulignerons que pour La Boétie, la liberté doit être conçue comme un combat permanent, individuel et collectif.
I. La liberté, un état naturel inscrit dans la condition humaine
Un don universel de la nature
La Boétie affirme avec force : « La nature, ministre de Dieu, nous ayant tous faits de même forme, comme pour nous tenir en compagnie, nous a faits tous libres ». La liberté est donc une donnée première, inséparable de l’humanité. Elle est constitutive de la fraternité et de l’égalité entre les hommes.
L’absence de nécessité d’un maître
L’auteur souligne l’inutilité du pouvoir imposé : « Il n’y a rien de si contraire à la nature, qui semble nous avoir mis ensemble, que de dire : Soyons esclaves les uns des autres ». Le maître n’est pas nécessaire, puisqu’il n’est qu’un homme comme les autres.
Une liberté intérieure, immédiate
La liberté est à la portée de chacun : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres ». Par cette formule, La Boétie souligne que la liberté est naturelle, toujours disponible, et qu’il suffit d’un acte de conscience pour la retrouver.
Ainsi, pour La Boétie, la liberté n’est pas un privilège mais une condition naturelle. Pourtant, paradoxalement, les hommes renoncent à cet état premier.
II. L’acceptation de la servitude : habitude, faiblesse et illusions
Le poids de l’habitude
« Les hommes nés sous le joug, nourris et élevés dans la servitude, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne songent pas à avoir d’autres biens ni d’autres droits que ceux qu’ils ont trouvés ». L’accoutumance transforme l’exception en normalité : ce n’est pas la force du tyran, mais la routine de l’obéissance qui explique la servitude.
Le consentement à l’asservissement
La Boétie insiste : « Le tyran n’a que deux yeux, deux mains, un seul corps, et n’a rien de plus que le moindre des hommes de la multitude ». S’il règne, ce n’est donc pas par sa puissance personnelle, mais parce que les hommes acceptent de le servir. Leur propre soumission lui donne ses armes.
La séduction et les artifices du pouvoir
La tyrannie s’entretient par des distractions et des illusions : « Ce sont les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les médailles et autres drogueries qui servaient d’appât à la servitude ». La liberté se perd non par contrainte, mais par une douce corruption qui détourne les hommes de leur vigilance.
La liberté est naturelle, mais elle se perd aisément par consentement, habitude ou séduction. C’est pourquoi La Boétie suggère qu’elle ne peut subsister qu’au prix d’un combat intellectuel et moral.
III. La liberté comme combat permanent, intellectuel et collectif
Un éveil de la conscience individuelle
La Boétie appelle ses lecteurs à une prise de conscience : « Soyez résolus de ne plus servir ». La liberté ne peut exister que si l’homme refuse intérieurement la servitude. C’est un combat permanent contre l’aveuglement et la résignation.
La résistance au pouvoir oppressif
L’auteur invite à une désobéissance pacifique : « Décidez de ne plus servir, et vous serez libres sans frapper un coup ». Il ne s’agit pas d’un soulèvement violent, mais d’un retrait du consentement qui nourrit le tyran. La liberté est un combat silencieux, mais exigeant.
Une vigilance commune
La Boétie dénonce le rôle des « quatre ou cinq » qui, en soutenant le tyran, asservissent tout un peuple. La liberté n’est donc pas seulement individuelle : elle exige une solidarité collective, une vigilance partagée. La servitude est contagieuse, mais la liberté aussi : elle se transmet par l’exemple et par la parole.
La liberté n’est pas un état figé : elle se maintient à travers une lutte constante de l’esprit et du corps social.
La Boétie propose une vision paradoxale de la liberté : elle est à la fois naturelle et immédiate, inscrite dans l’humanité, mais aussi menacée et fragile, puisque les hommes se laissent séduire par l’habitude et le confort de la servitude. De là découle son appel : la liberté doit être envisagée comme un combat permanent, qui exige à la fois lucidité individuelle et résistance collective.
Ouverture : Cette réflexion, écrite au XVIᵉ siècle, conserve une grande actualité : à l’heure des manipulations de masse et des séductions médiatiques, la servitude volontaire peut prendre des formes nouvelles. La leçon de La Boétie est claire : la liberté n’est jamais donnée, elle est toujours à défendre.
Autre dissertation sur le même sujet
Dès l’Antiquité, les philosophes et les moralistes se sont interrogés sur la condition humaine : l’homme est-il né libre, ou condamné à subir des formes de domination ? Dans son Discours de la servitude volontaire (vers 1549), Étienne de La Boétie formule une idée paradoxale et provocante : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres ». Autrement dit, si les hommes vivent sous la tyrannie, ce n’est pas à cause de la force du tyran, mais parce qu’ils acceptent eux-mêmes de se soumettre. Or, ce constat n’appartient pas seulement au XVIᵉ siècle : il résonne encore aujourd’hui, dans les luttes politiques, sociales et philosophiques autour de la liberté. Faut-il alors considérer la liberté comme un état naturel inscrit dans la condition humaine, que l’homme perd par négligence, ou bien comme un combat permanent, à recommencer sans cesse, pour résister aux forces qui menacent de l’abolir ?
Problématique : La liberté, selon La Boétie et les auteurs du parcours, est-elle une donnée essentielle de la nature humaine ou bien un acquis toujours fragile, à défendre au prix d’un effort constant ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que la liberté est bien, selon La Boétie et la philosophie des Lumières, un état naturel. Mais nous montrerons ensuite que l’homme, par habitude et par faiblesse, s’expose à perdre cette liberté. Enfin, nous verrons que la véritable liberté n’est jamais donnée : elle suppose un combat intellectuel, moral et collectif permanent.
I. La liberté, un état naturel inscrit dans la condition humaine
La liberté comme essence de l’homme
La Boétie rappelle que la liberté est inscrite dans la nature : « La nature, ministre de Dieu, nous ayant tous faits de même forme, comme pour nous tenir en compagnie et nous convier à la fraternité ». L’égalité et la liberté sont donc le point de départ. Rousseau reprendra la même idée au XVIIIᵉ siècle : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers » (Du contrat social).
La liberté comme droit inaliénable
Pour Montesquieu, dans De l’esprit des lois, la liberté n’est pas seulement une donnée de nature : c’est aussi le droit de « faire ce que les lois permettent », c’est-à-dire un cadre juridique qui garantit aux hommes de ne pas tomber sous l’arbitraire. La liberté est donc conçue comme un droit fondamental qui accompagne la condition humaine.
Un bien universel et premier
Dans la littérature du parcours, notamment chez Madame de Graffigny (Lettres d’une Péruvienne), la liberté apparaît comme une exigence universelle : Zilia, arrachée à sa patrie, souffre de la perte de son indépendance et découvre les contraintes sociales européennes. La liberté est donc un état premier dont la privation est ressentie comme un arrachement.
La liberté semble donc naturelle et fondamentale. Mais La Boétie insiste : malgré cela, les hommes s’asservissent d’eux-mêmes.
II. L’habitude et la faiblesse humaine : causes de la perte de la liberté
L’habitude de la servitude
La Boétie montre que « les hommes, nés sous le joug, nourris et élevés dans la servitude, se contentent de vivre comme ils sont nés ». L’habitude fait que l’on prend la servitude pour naturelle. La liberté, au contraire, demande un effort de conscience.
Le consentement à la domination
Le tyran est faible : « Il n’a que deux yeux, deux mains, un seul corps, et n’a rien de plus que le moindre des hommes ». Mais il tient sa force du peuple qui accepte de l’entretenir : « Ce sont quatre ou cinq qui maintiennent le tyran, quatre ou cinq qui en tiennent tout le pays asservi ». La passivité des masses fabrique donc la domination.
La séduction et les artifices du pouvoir
La Boétie dénonce les stratégies de diversion : « Ce sont les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les médailles et autres drogueries qui servaient d’appât à la servitude ». La liberté est perdue lorsque l’homme se laisse séduire par le confort, le divertissement ou les avantages matériels.
La liberté naturelle peut donc toujours se perdre : la faiblesse humaine, l’habitude et la séduction des tyrans en sont les causes. Mais cela conduit à penser que la liberté est moins un état donné qu’un combat à mener.
III. La liberté comme combat permanent et comme exigence morale
Un effort de conscience et de volonté
La Boétie l’affirme : « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres ». La liberté n’est pas une situation donnée une fois pour toutes : elle dépend d’un acte de lucidité et de décision. Elle suppose de rompre avec l’aveuglement collectif.
Un combat intellectuel et politique
Pour Montesquieu, il faut inventer des institutions équilibrées pour préserver la liberté : la séparation des pouvoirs est conçue comme une barrière permanente contre l’arbitraire. De même, Camus, dans L’Homme révolté, rappelle que « l’homme révolté est celui qui dit non, mais son refus fonde une affirmation : il se bat pour une liberté commune ».
Une vigilance collective
La liberté n’est pas seulement individuelle, elle suppose une solidarité et une responsabilité politique. Zilia, chez Graffigny, découvre que la liberté d’une femme peut être limitée par les conventions sociales : défendre la liberté, c’est aussi élargir le combat à toutes les formes d’oppression. La liberté se défend dans le temps, car elle est toujours menacée par de nouveaux pouvoirs.
La liberté est donc moins un état qu’un processus : elle demande une lutte constante, intellectuelle et civique.
Ainsi, la liberté apparaît d’abord comme un bien naturel et universel, inscrit dans la condition humaine. Pourtant, comme le montre La Boétie, les hommes renoncent souvent à ce bien en s’habituant à la servitude et en entretenant eux-mêmes le pouvoir qui les opprime. Cela conduit à concevoir la liberté comme un combat permanent, exigeant un effort de vigilance, de réflexion et de résistance. Elle n’est jamais acquise une fois pour toutes, mais doit toujours être entretenue et défendue.
Ouverture : Aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, des manipulations de masse et des nouvelles formes de contrôle, la leçon de La Boétie reste d’une brûlante actualité : il suffit parfois d’un simple consentement, d’un simple abandon de vigilance, pour que la liberté se transforme en servitude.
Fiche de citations
1. Nature et liberté originelle
« La nature, ministre de Dieu, nous ayant tous faits de même forme, comme pour nous tenir en compagnie et nous convier à la fraternité. »
L’homme est naturellement libre et égal.
« L’homme est né libre et partout il est dans les fers. » (formule de Rousseau, en écho à La Boétie).
À utiliser pour mettre en perspective.
2. L’habitude de la servitude
« Les hommes, nés sous le joug, nourris et élevés dans la servitude, se contentent de vivre comme ils sont nés. »
L’habitude détruit le désir de liberté.
« Ce mal est enraciné par l’habitude et devient naturel. »
L’aliénation se transmet de génération en génération.
3. La passivité du peuple
« Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! »
L’adresse directe souligne l’indignation de l’auteur.
« Ils se laissent si bien aller qu’ils se privent de leurs biens propres. »
Le peuple renonce lui-même à sa liberté.
4. Le mécanisme de la domination
« Ce sont les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étrangères, les médailles, les tableaux, et autres drogueries de cette sorte, qui servaient d’appât à la servitude. »
Le tyran détourne et corrompt par les plaisirs.
« Le tyran n’a que deux yeux, deux mains, un seul corps, et n’a rien de plus que le moindre des hommes qui sont du nombre infini de vos villes. »
Le tyran est faible, sa force vient de la soumission collective.
« Ce sont quatre ou cinq qui maintiennent le tyran, quatre ou cinq qui en tiennent tout le pays asservi. »
Description en cascade de la domination.
5. La tyrannie comme illusion
« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »
Le pouvoir du tyran repose sur l’illusion de sa grandeur.
« Il n’est pas besoin de le combattre, mais seulement de ne plus le soutenir. »
Le pouvoir s’effondrerait si le peuple retirait son consentement.
6. L’appel à la liberté
« Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres. »
La liberté dépend d’un acte de volonté.
« C’est le peuple qui s’asservit, qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d’être libre, préfère se soumettre. »
Responsabilité morale du peuple.
Etienne de La Boétie
Discours de la servitude volontaire
Parcours : Défendre et entretenir la liberté


 Sujet 1 :
Sujet 1 :