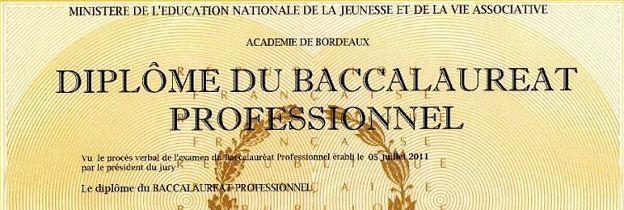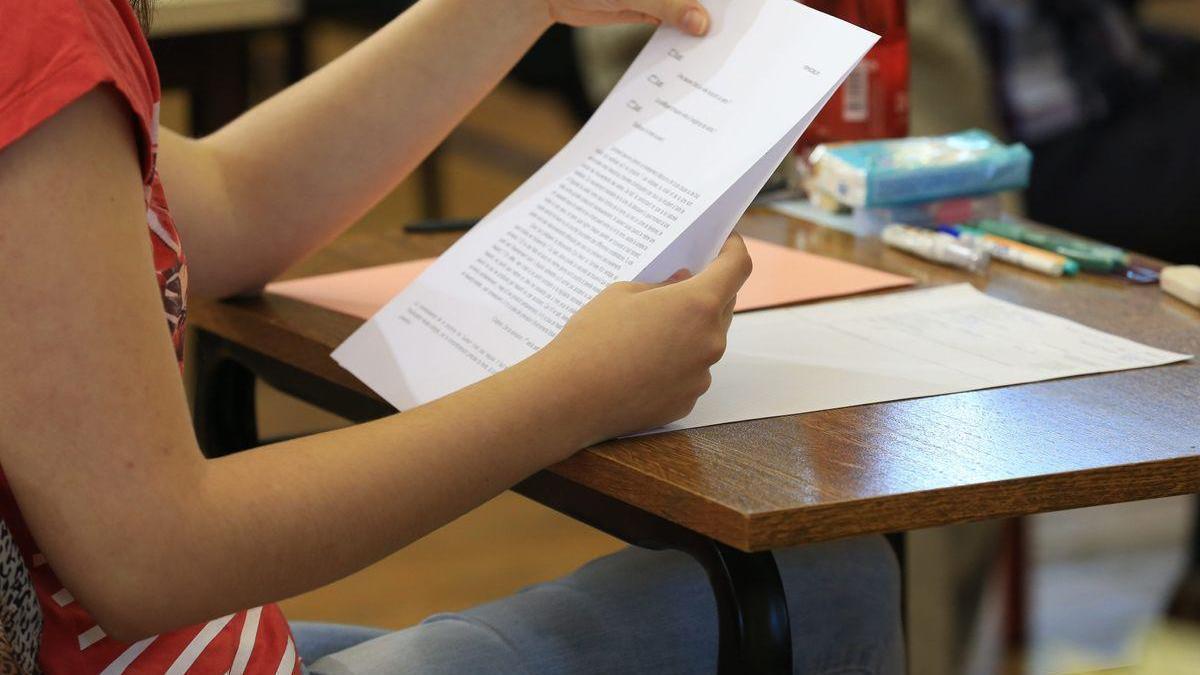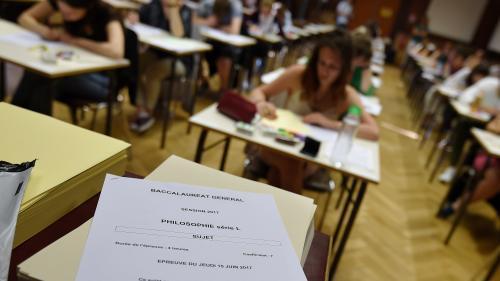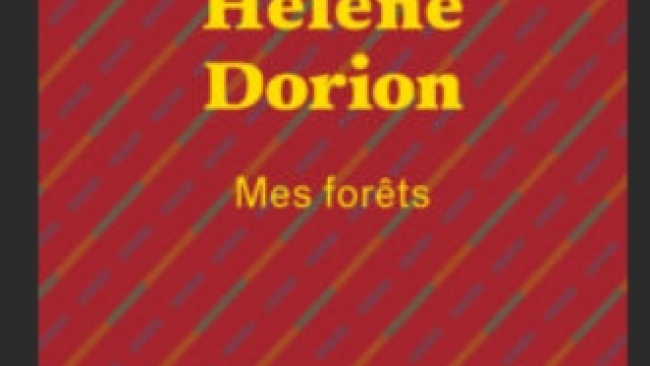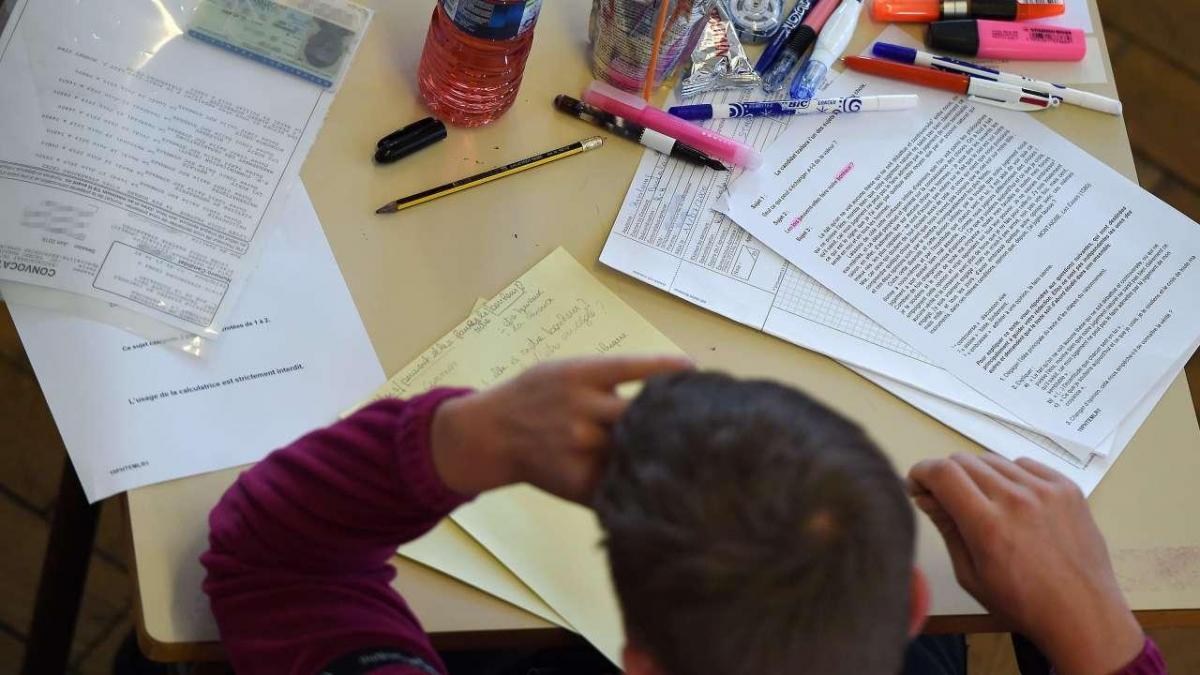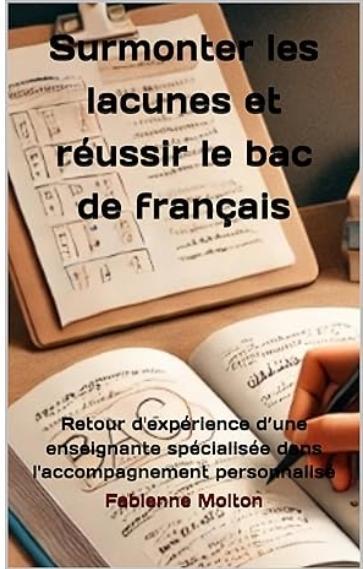Epreuve : Bac Général
Matière : Français
Classe : Première
Centre : Polynésie française
Date : vendredi 13 juin 2025
Durée : 4h
Consultez les sujets du bac 2025
 2025 francais voie generale (330.22 Ko)
2025 francais voie generale (330.22 Ko)
Commentaire
Victor Segalen, Stèles (1912), « Conseils au bon voyageur »
Médecin, explorateur et poète, Victor Segalen (1878-1919) a parcouru la Chine et la Polynésie, et a nourri son œuvre d’une réflexion sur l’altérité et sur la richesse de la diversité du monde. Dans Stèles (1912), il adopte une forme inspirée des inscriptions gravées sur pierre en Chine ancienne, à la fois solennelle et méditative. Le texte « Conseils au bon voyageur » se présente comme une série d’injonctions destinées à guider le lecteur dans sa manière de voyager. Mais le voyage est-il seulement une expérience géographique, ou bien aussi une métaphore de l’existence et de la quête de sens ?
Problématique : Comment Segalen fait-il du voyage une expérience poétique et philosophique, où la diversité devient une valeur fondamentale ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que le poème propose une véritable éthique du voyage (I), puis qu’il valorise une alternance féconde des contraires (II), avant de montrer qu’il conduit à une philosophie de la diversité comme horizon ultime (III).
I. Une véritable éthique du voyage
Un texte sous forme d’instructions.
Le poème adopte la forme d’un manuel, avec des impératifs (« ne choisis donc pas », « aime », « repose-toi »), qui donnent au texte une valeur prescriptive, presque comme un code de conduite. Le lecteur est placé en position d’apprenti voyageur.
Un art de vivre plus qu’un simple voyage.
Les conseils ne portent pas seulement sur des paysages ou des itinéraires, mais sur des attitudes existentielles : « si tu sais être seul », « garde bien d’élire un asile ». Le voyage devient une métaphore de la vie humaine, qui doit se garder de la routine et de l’immobilité.
Une quête de liberté.
Le poète rejette toute entrave : « sans licol et sans étable ». L’éthique du voyageur est celle d’une existence affranchie des contraintes, qui ne vise ni « mérites » ni « peines », mais une forme de liberté intérieure.
II. L’alternance des contraires comme principe fondateur
Ville et route, montagne et plaine.
Le poème valorise les contraires : l’enfermement de la montagne et l’ouverture de la plaine, la stabilité de la ville et le mouvement de la route. Loin de choisir, le voyageur doit alterner et goûter les deux expériences.
Silence et son, solitude et foule.
L’alternance s’étend à l’expérience sensible : l’oreille doit savourer le silence puis revenir au son ; l’homme doit savoir être seul mais aussi se « déverser » dans la foule. La diversité naît de ce passage d’un extrême à l’autre.
Douceur et intensité.
Le poème conseille de rompre la fadeur par « quelque forte épice qui brûle et morde ». Le voyage n’est pas une monotonie mais une intensification des expériences, qui se nourrissent du contraste.
III. La diversité comme horizon poétique et philosophique
Un rejet des absolus figés.
Segalen refuse l’« asile » ou la « vertu durable » : toute fixité est un danger. Le voyage est une manière d’éviter les certitudes définitives, au profit d’un perpétuel renouvellement.
Un idéal de mouvement.
La formule « sans arrêt ni faux pas » indique un cheminement continu, fluide. Le voyage n’a pas de terme immobile mais se nourrit de son propre dynamisme.
La célébration de la diversité.
Le poème s’achève sur une antithèse décisive : non pas « le marais des joies immortelles » (immobilité stérile), mais « les remous pleins d’ivresses du grand fleuve Diversité ». L’horizon ultime du voyage est la célébration de la variété infinie des expériences humaines et du monde.
Dans ce poème de Stèles, Victor Segalen fait du voyage une véritable métaphore de l’existence. Loin de rechercher la stabilité ou une vérité unique, il propose une éthique du mouvement, de l’alternance et de la diversité. L’art de voyager est ainsi un art de vivre, fondé sur la richesse de l’altérité et le refus des absolus immobiles.
Ouverture : Cette philosophie de la diversité fait écho à une conception moderne de l’altérité, proche de la pensée de Montaigne ou plus tard de celle de Claude Lévi-Strauss : se connaître soi-même, c’est aussi savoir accueillir et valoriser la différence des autres.
Dissertation 1
Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Le candidat traite au choix, compte tenu de l’œuvre et du parcours associé étudiés durant l’année, l’un des trois sujets suivants :
A. Œuvre : Pierre Corneille, Le Menteur Parcours : Mensonge et comédie
Un critique écrit à propos du Menteur : « Si la comédie entretient des relations privilégiées avec le mensonge, c’est qu’il est rare qu’un mensonge reste sans suites ». En quoi cette citation éclaire-t-elle le rôle du mensonge dans la comédie de Corneille ?
Vous répondrez dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l’œuvre de Pierre Corneille au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.
Corrigé du sujet :
« Si la comédie entretient des relations privilégiées avec le mensonge, c’est qu’il est rare qu’un mensonge reste sans suites ». En quoi cette citation éclaire-t-elle le rôle du mensonge dans Le Menteur de Corneille ?
La comédie, depuis ses origines antiques, met en scène des travers humains avec humour et ironie, afin d’amuser tout en provoquant une réflexion morale. Dans Le Menteur (1644), Pierre Corneille explore le thème du mensonge à travers le personnage de Dorante, jeune homme séduisant mais fabulateur, dont les inventions entraînent quiproquos et malentendus.
Un critique affirme que si la comédie entretient un lien privilégié avec le mensonge, c’est parce qu’« il est rare qu’un mensonge reste sans suites ». Cette remarque éclaire le rôle central du mensonge dans la pièce : moteur de l’action, source de comique et révélateur des comportements humains.
Problématique : En quoi le mensonge, dans Le Menteur de Corneille, dépasse-t-il une simple ruse individuelle pour devenir le ressort comique et critique de la comédie ?
Annonce du plan : Nous montrerons d’abord que le mensonge constitue le moteur dramatique et comique de la pièce (I), puis qu’il entraîne des suites imprévisibles et fécondes pour l’intrigue (II), enfin qu’il éclaire, de manière plus profonde, la fonction morale et sociale de la comédie (III).
I. Le mensonge, moteur dramatique et comique de la pièce
Un ressort narratif essentiel.
Dorante invente des histoires pour séduire, se grandir et échapper à la vérité : il se vante d’exploits militaires, raconte une fausse rencontre galante… Ces inventions déclenchent et alimentent l’intrigue.
Un mécanisme comique universel.
Comme dans la tradition de la farce ou de Molière, le mensonge suscite le rire du spectateur, qui connaît la vérité et se délecte des maladresses du menteur. Le comique de situation (quiproquos, malentendus) est directement nourri par les mensonges de Dorante.
Un portrait caricatural du menteur.
Dorante incarne un type comique : celui du fabulateur. Son talent à inventer des récits outrés provoque l’admiration mais aussi le ridicule. Corneille s’inscrit ainsi dans la veine de la comédie de caractère.
II. Le mensonge et ses suites imprévisibles : l’engrenage de l’intrigue
Le mensonge entraîne des complications.
Chaque mensonge oblige Dorante à en inventer un nouveau pour cacher le précédent. L’action se construit sur cet enchaînement inévitable.
Les quiproquos amoureux.
Dorante confond Clarice et Lucrèce, ce qui entraîne des situations comiques de méprise. Le spectateur voit bien comment un mensonge, destiné à séduire, se retourne contre lui.
La vérité finit par s’imposer.
Comme souvent dans la comédie, le mensonge ne peut durer éternellement : il aboutit à une révélation, qui permet la résolution de l’intrigue. L’idée que « le mensonge a des suites » prend tout son sens : il prépare la vérité.
III. Une réflexion morale et sociale sur la comédie et le mensonge
Le mensonge comme critique des comportements humains.
Par Dorante, Corneille dénonce la vanité, le goût du paraître et la manipulation amoureuse. Le spectateur rit mais prend aussi conscience de travers universels.
Un apprentissage de la vérité.
Dorante finit par reconnaître ses fautes et tirer une leçon de ses mensonges. La comédie remplit ici une fonction éducative : elle fait rire mais aussi réfléchir.
La comédie, miroir de la société.
En mettant en scène le mensonge et ses suites, Corneille montre la difficulté des relations sociales et amoureuses, où la sincérité est constamment menacée par l’illusion et le jeu des apparences. Le mensonge révèle ainsi la fragilité des rapports humains.
Dans Le Menteur, le mensonge n’est pas un simple motif secondaire : il est au cœur de la construction dramatique, source de comique et moteur de l’action. Comme le souligne la citation, un mensonge entraîne toujours des suites : enchaînements de quiproquos, complications amoureuses, révélations finales. Mais au-delà du rire, Corneille fait du mensonge un révélateur moral, qui éclaire les travers humains et invite à réfléchir sur la valeur de la sincérité dans la vie sociale.
Ouverture : Ce rôle du mensonge dépasse Le Menteur : dans toute la tradition comique, de Molière (Tartuffe, L’Avare) jusqu’au théâtre contemporain, le mensonge reste un ressort dramatique privilégié, car il met en lumière, avec humour, les faiblesses universelles de l’homme.
Dissertation 2
B. Œuvre : Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour
Parcours : Les jeux du cœur et de la parole
Dans quelle mesure le jeu de la parole nuit-il à l'expression sincère des sentiments dans On ne badine pas avec l'amour ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l’œuvre d’Alfred de Musset au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.
Sujet :
Dans quelle mesure le jeu de la parole nuit-il à l’expression sincère des sentiments dans On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset ?
Alfred de Musset (1810-1857), poète et dramaturge romantique, met en scène dans On ne badine pas avec l’amour (1834) une histoire d’amour contrariée entre Perdican et Camille. Leurs sentiments sont profonds, mais leur relation échoue tragiquement, en grande partie à cause du rôle des mots : ironie, provocation, dissimulation. Dans cette pièce, l’amour est soumis à un jeu verbal qui mêle séduction et cruauté.
Dès lors, on peut se demander : le jeu de la parole favorise-t-il l’expression de la sincérité, ou au contraire en constitue-t-il l’obstacle principal ?
Problématique : Dans quelle mesure la parole, dans On ne badine pas avec l’amour, devient-elle un jeu qui empêche les personnages de dire leurs véritables sentiments ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que la parole est utilisée comme un instrument de séduction et de pouvoir (I), puis qu’elle devient un jeu cruel où se cache la sincérité des sentiments (II), enfin qu’elle conduit à un dénouement tragique qui révèle l’échec de la parole et la vérité de l’amour (III).
I. La parole comme instrument de séduction et de pouvoir
Un jeu mondain et amoureux.
Les personnages, notamment Perdican, manient la parole avec esprit et légèreté. Les réparties vives, les bons mots et les déclarations ambiguës servent à séduire et à se donner une image valorisante.
Un héritage romantique et aristocratique.
Dans la société représentée par Musset, le langage est un outil de brillance sociale. Il faut savoir jouer avec les mots pour exister : c’est un signe de culture et de distinction.
La parole, miroir des rapports de force.
Perdican utilise la parole pour provoquer Camille ; Camille, de son côté, se réfugie derrière des paroles de piété et de vertu pour se protéger. Le langage n’est donc pas neutre, mais une arme dans la relation amoureuse.
II. Un jeu cruel qui empêche l’expression sincère des sentiments
L’ironie et la dissimulation.
Perdican, par orgueil, dissimule son amour derrière des paroles moqueuses et des déclarations à Rosette. Camille, par fierté, cache son trouble derrière un discours religieux. Chacun parle pour ne pas dire ce qu’il ressent.
Les malentendus et quiproquos.
Le langage ambigu entraîne une incompréhension entre les personnages. Perdican pense se venger de Camille en séduisant Rosette, mais ses paroles blessent profondément les deux jeunes filles.
Une parole qui déforme la vérité des cœurs.
L’amour sincère existe, mais il ne parvient pas à s’exprimer pleinement : il est étouffé par les jeux rhétoriques, les sous-entendus, la peur d’avouer sa vulnérabilité.
III. L’échec de la parole et la vérité tragique de l’amour
Le langage mène au drame.
Les paroles de Perdican adressées à Rosette, entendues par Camille, provoquent la mort de Rosette. Ici, la parole n’est plus un jeu inoffensif : elle devient fatale.
La vérité révélée trop tard.
Camille et Perdican s’aiment sincèrement, mais leur fierté et leur jeu verbal retardent l’aveu. La sincérité n’apparaît qu’au prix de la tragédie, quand il n’est plus possible de réparer.
La pièce comme réflexion sur la fragilité du langage.
Musset montre que la parole est à la fois nécessaire pour exprimer l’amour et incapable de traduire la profondeur des sentiments. Le silence, au final, dit plus que les mots : c’est le non-dit qui fait éclater la vérité.
Dans On ne badine pas avec l’amour, la parole, loin de révéler spontanément les sentiments, devient un jeu dangereux qui masque la sincérité et provoque des malentendus tragiques. Instrument de séduction, elle se transforme en arme de provocation et d’orgueil, jusqu’à causer la mort de Rosette et l’échec de l’amour entre Perdican et Camille. Musset met ainsi en garde contre les excès du badinage verbal : on ne joue pas impunément avec le langage quand il s’agit de l’amour.
Ouverture : Cette réflexion dépasse Musset : elle interroge la nature même du langage amoureux. De Marivaux, où les jeux de langage retardent l’aveu, jusqu’au théâtre contemporain, la comédie comme le drame montrent que l’amour souffre toujours d’un écart entre ce que l’on ressent et ce que l’on dit.
Dissertation 3
C. Œuvre : Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non
Parcours : Théâtre et dispute
Selon un critique, dans Pour un oui ou pour un non, « ce sont les non-dits, les sous-entendus, ce qui se tisse entre les mots, qui sont la source des malentendus, qui minent les relations humaines », c’est-à-dire qui les fragilisent. En quoi ces propos éclairent-ils votre lecture de la pièce ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l’œuvre de Nathalie Sarraute au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.
Sujet :
Selon un critique, dans Pour un oui ou pour un non, « ce sont les non-dits, les sous-entendus, ce qui se tisse entre les mots, qui sont la source des malentendus, qui minent les relations humaines ». En quoi ces propos éclairent-ils votre lecture de la pièce ?
Nathalie Sarraute, écrivaine du XXᵉ siècle et figure du Nouveau Roman, transpose dans le théâtre les recherches d’une écriture qui traque l’infra-ordinaire, les « tropismes », ces mouvements invisibles qui animent les relations humaines. Dans Pour un oui ou pour un non (1982), une simple dispute éclate entre deux amis, à cause d’une expression banale – « C’est bien… ça » – qui déclenche une cascade d’interprétations et de reproches.
Le critique souligne que ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais leurs non-dits et leurs sous-entendus qui fragilisent la relation. Cela conduit à s’interroger :
Problématique : En quoi les sous-entendus et les silences, au cœur de Pour un oui ou pour un non, révèlent-ils la fragilité des relations humaines et le pouvoir destructeur du langage ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que Sarraute met en évidence le rôle des mots et des intonations dans la naissance du conflit (I), puis que les sous-entendus et les malentendus nourrissent et amplifient la dispute (II), enfin que cette pièce interroge plus largement la fragilité des relations humaines et la difficulté de communiquer sincèrement (III).
I. Le poids des mots et des intonations dans la relation
Un mot insignifiant qui déclenche tout.
La pièce commence par un simple « C’est bien… ça », expression banale en apparence. Mais H2 y perçoit une ironie blessante. Cela montre que le conflit naît non pas du sens littéral des mots, mais de la manière dont ils sont entendus.
Le rôle déterminant du ton et du sous-entendu.
Sarraute insiste sur les « inflexions » de la voix, ces nuances qui portent un jugement implicite. C’est le ton, plus que le contenu, qui offense.
Un langage piégé.
Les personnages se trouvent pris dans les pièges du langage quotidien : chaque formule peut être soupçonnée de dissimuler une condescendance, une ironie, un mépris. Le langage devient un terrain miné.
II. Les non-dits et les malentendus comme sources du conflit
L’importance de l’interprétation.
Ce que dit l’un n’est jamais reçu tel quel : l’autre y lit des sous-entendus. Le malentendu est permanent, car chacun interprète en fonction de ses attentes, de sa sensibilité, de ses blessures.
Une dispute sans véritable fondement.
La querelle ne repose sur aucun fait objectif : elle se nourrit de ce qui se « tisse entre les mots ». Ainsi, la pièce met en lumière la disproportion entre la cause (un mot banal) et la conséquence (une rupture amicale).
Le langage comme révélateur de l’inconscient.
Derrière les mots se jouent des enjeux affectifs profonds : peur d’être méprisé, orgueil blessé, besoin de reconnaissance. Les non-dits révèlent ce qui échappe au contrôle des personnages.
III. Une réflexion sur la fragilité des relations humaines et sur la communication
L’amitié mise en péril.
Le lien amical, a priori solide, se défait pour un détail linguistique. Cela montre combien les relations humaines reposent sur un équilibre fragile, vulnérable aux malentendus.
Une critique de la communication ordinaire.
Sarraute dévoile les limites du langage quotidien, où la transparence est impossible. Chaque mot est sujet à interprétation, chaque silence est lourd de sens.
Une portée universelle.
Derrière une dispute minuscule, Sarraute met en scène l’impossibilité d’une communication totalement sincère. La pièce illustre une vérité humaine : nos relations sont fragiles parce qu’elles passent par le filtre incertain du langage.
Le propos du critique éclaire pleinement Pour un oui ou pour un non. Sarraute y montre que les mots ne sont jamais neutres : leurs inflexions, leurs silences et leurs sous-entendus pèsent lourdement sur nos relations. Les malentendus naissent de ces zones invisibles entre les mots et minent l’amitié comme l’amour. Ainsi, la pièce illustre avec force la fragilité de la communication humaine.
Ouverture : D’autres dramaturges, de Molière à Ionesco, ont montré que le langage pouvait être source de comédie ou d’absurde. Mais chez Sarraute, cette fragilité n’est pas risible : elle traduit l’impossibilité tragique de se dire pleinement à autrui.
Consultez les sujets corrigés du bac 2024
- – Arthur Rimbaud, Cahier de Douai / Parcours : Émancipations créatrices.
- Les poèmes de Rimbaud dans le Cahier de Douai ne sont-ils que des poèmes de l’émancipation ?
- Corrigé bac
- Hélène Dorion écrit à propos des forêts : « et quand je m’y promène / c’est pour prendre le large / vers moi-même ».
- Les promenades d’Hélène Dorion dans ses forêts ne sont-elles qu’un voyage à l’intérieur de soi ?
- Correction
- Dans La rage de l’expression, pensez-vous que Francis Ponge ne cherche à donner à voir que son travail d’écriture ?
- Correction
La Poésie à l'honneur au bac de français 2024
Le Bac de français 2024 a consacré la poésie comme un pilier incontournable de la culture littéraire. Ce genre littéraire a dominé les épreuves écrites avec une sélection de trois œuvres majeures qui ont nourri douze sujets de dissertation, répartis entre la métropole, les centres étrangers et les DOM-TOM. Parmi ces œuvres, celles de Rimbaud, Francis Ponge et Hélène Dorion ont offert aux candidats une plongée dans des univers poétiques singuliers et profonds.
- Métropole
- Dans Mes forêts, Hélène Dorion écrit : « mes forêts racontent une histoire ».
- En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l’œuvre ?
- Deux corrigés bac
- Groupe 1, Centres Etrangers
- Dans mes forêts, la nature n'est-elle qu'une métaphore de l'intériorité?
- Correction - Autre correction
- Centres Etrangers. Amérique du nord
- Sujet : Le recueil Mes forêts est-il seulement un chant personnel ?
- Correction
- Métropole
- Dans le poème « Sensation », Arthur Rimbaud écrit: « j'irai loin, bien loin ».
- Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet ?
- Correction - Autre correction
- Centres Etrangers, Groupe 1
- Un critique écrit à propos d’Arthur Rimbaud : « Son désir ? Tout réinventer, tout vivre, tout redire. Tout abattre d’abord ».
- Dans quelle mesure cette citation éclaire-t-elle votre lecture du recueil Cahier de Douai ?
- Correction
- Amérique du nord, Centres Etrangers
- Sujet : On a dit de Rimbaud qu’il était un des « grands aventuriers du rêve ».
- Cette affirmation éclaire-t-elle votre lecture des Cahiers de Douai ?
- Correction
- Métropole
- Selon un critique, La rage de l'expression donne à voir « l'écriture en plein travail et se regardant travailler ».
- Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre ?
- Correction - Autre corrigé
- Centres Etrangers, Groupe 1
- Un critique affirme : « Chaque fois recommencée, sans aboutissement possible, l’œuvre s’explore, progresse péniblement, cherche sa propre fluidité, son bon écoulement ».
- En quoi cette réflexion vous paraît-elle pouvoir éclairer le travail à l’œuvre dans la Rage de l’expression ?
- Correction - Autre corrigé
- Centres Etrangers, Groupe 2
- Sujet : Dans son poème « Le Mimosa », Francis Ponge écrit : « Il faut que je prenne le lecteur par la main […] en lui affirmant qu’il goûtera sa récompense lorsqu’il se trouvera enfin amené par mes soins au cœur du bosquet de mimosas […] ».
- Cette affirmation éclaire-t-elle, selon vous, le projet poétique du recueil La Rage de l’expression ?
- Correction