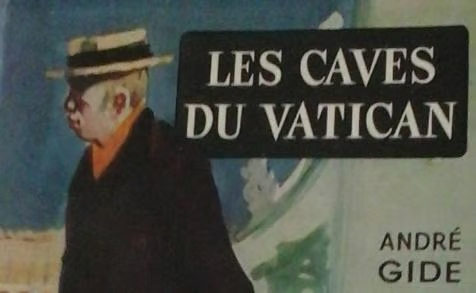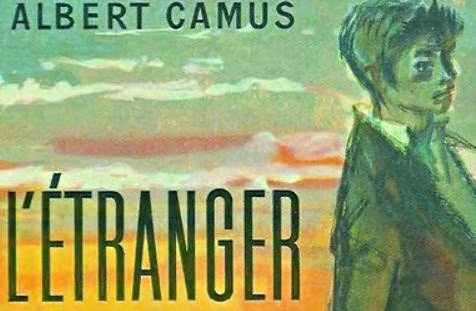Nietzsche, Crépuscule des idoles : commentaire philosophique
Le même remède, la castration et l’extirpation, est employé instinctivement dans la lutte contre le désir par ceux qui sont trop faibles de volonté, trop dégénérés pour pouvoir imposer une mesure à ce désir ; par ces natures qui ont besoin de la Trappe, pour parler en image (et sans image), d’une définitive déclaration de guerre, d’un abîme entre eux et la passion. Ce ne sont que les dégénérés qui trouvent les moyens radicaux indispensables ; la faiblesse de volonté, pour parler plus exactement, l’incapacité de ne point réagir contre une séduction n’est elle-même qu’une autre forme de la dégénérescence. L’inimitié radicale, la haine à mort contre la sensualité est un symptôme grave : on a le droit de faire des suppositions sur l’état général d’un être à tel point excessif. — Cette inimitié et cette haine atteignent d’ailleurs leur comble quand de pareilles natures ne possèdent plus assez de fermeté, même pour les cures radicales, même pour le renoncement au « démon ». Que l’on parcoure toute l’histoire des prêtres et des philosophes, y compris celle des artistes : ce ne sont pas les impuissants, pas les ascètes qui dirigent leurs flèches empoisonnées contre les sens, ce sont les ascètes impossibles, ceux qui auraient eu besoin d’être des ascètes…
Dans Le Crépuscule des idoles (1888), Nietzsche entreprend une vaste entreprise de démystification des valeurs morales et religieuses de l’Occident. Il s’agit, selon lui, d’en finir avec les idoles de la pensée — ces illusions morales qui, sous couvert de sagesse ou de vertu, masquent en réalité une dégénérescence vitale.
Dans le passage proposé, Nietzsche s’attaque à la haine du désir et à la tendance de certains hommes à combattre la sensualité en prônant la castration, le renoncement et l’ascétisme. Pour lui, cette attitude n’est pas signe de grandeur morale, mais au contraire symptôme d’une faiblesse.
Problématique :
Comment Nietzsche renverse-t-il la valeur morale traditionnellement associée à la lutte contre les désirs, pour y déceler une maladie de la volonté et une décadence de la vie ?
Annonce du plan (mouvements du texte) :
Le texte se divise en trois mouvements :
(→ début à « …d’un abîme entre eux et la passion. ») Nietzsche décrit le réflexe maladif de ceux qui cherchent à extirper le désir plutôt qu’à le maîtriser.
(→ « Ce ne sont que les dégénérés… » à « …à tel point excessif. ») Il en déduit une véritable pathologie morale : la haine du corps est le signe d’une dégénérescence vitale.
(→ « Cette inimitié et cette haine… » jusqu’à la fin) Nietzsche pousse sa critique à l’extrême en montrant que ceux qui condamnent le plus violemment la sensualité sont les plus impuissants, les « ascètes impossibles ».
MOUVEMENT 1 — Le réflexe maladif de la castration morale
(Du début jusqu’à « …d’un abîme entre eux et la passion. »)
Dès la première phrase, Nietzsche adopte un ton polémique :
« Le même remède, la castration et l’extirpation, est employé instinctivement dans la lutte contre le désir… »
Le vocabulaire médical — remède, castration, extirpation — est ici ironique. Ce qui est présenté comme une « guérison » est en réalité, pour Nietzsche, un symptôme morbide. Le philosophe dénonce un instinct de mutilation chez ceux qui veulent éradiquer le désir au lieu de le discipliner.
L’expression « ceux qui sont trop faibles de volonté » renverse le sens moral classique : d’ordinaire, c’est la maîtrise du désir qui manifeste la force morale ; ici, c’est le refus même du désir qui prouve la faiblesse.
Ces êtres « trop dégénérés pour pouvoir imposer une mesure à ce désir » ne savent pas vivre selon une mesure intérieure — la modération, pour Nietzsche, suppose la puissance, la maîtrise de soi ; son absence mène à l’excès inverse, la répression.
L’image de la Trappe (référence à l’ordre monastique très strict) illustre cette fuite radicale devant la vie : les faibles ont besoin « d’un abîme entre eux et la passion ».
Ainsi, dans ce premier mouvement, Nietzsche montre que la morale ascétique, sous couvert de sainteté, n’est qu’un refuge pour les impuissants, incapables d’assumer la vitalité du désir.
Ce n’est pas la vertu, mais la peur de vivre, qui pousse à la castration morale.
MOUVEMENT 2 — La haine du corps comme symptôme de dégénérescence
(De « Ce ne sont que les dégénérés… » à « …à tel point excessif. »)
Nietzsche généralise son diagnostic en termes biologiques :
« Ce ne sont que les dégénérés qui trouvent les moyens radicaux indispensables. »
Le lexique médical se renforce : dégénérescence, symptôme grave, état général.
Il ne s’agit plus seulement d’une erreur morale, mais d’un mal physiologique : la haine du désir trahit une maladie de la vie.
La phrase :
« La faiblesse de volonté, pour parler plus exactement, l’incapacité de ne point réagir contre une séduction n’est elle-même qu’une autre forme de la dégénérescence »
souligne le cœur de la thèse nietzschéenne : la volonté forte sait résister sans se mutiler. Le faible, lui, ne peut qu’éradiquer ce qu’il ne sait dominer.
L’« inimitié radicale » et la « haine à mort contre la sensualité » deviennent les signes d’un excès maladif.
Le mot « excessif » renvoie à une inversion des valeurs : celui qui veut se purifier totalement du corps est lui-même dominé par une passion — la passion de la négation.
Plus la morale prétend être pure, plus elle révèle une vitalité malade.
Ce second mouvement approfondit le diagnostic : la morale ascétique n’est pas une victoire sur les passions, mais une passion retournée contre la vie elle-même.
MOUVEMENT 3 — Les ascètes impossibles : la maladie devenue morale
(De « Cette inimitié et cette haine… » à la fin du texte)
Nietzsche va plus loin :
« Cette inimitié et cette haine atteignent d’ailleurs leur comble quand de pareilles natures ne possèdent plus assez de fermeté, même pour les cures radicales. »
Il dépeint ici les cas désespérés : ceux qui ne peuvent même plus renoncer. Trop faibles pour vivre leurs désirs, mais aussi trop faibles pour les étouffer, ils sombrent dans la haine impuissante.
Leur morale devient ressentiment, selon le concept central de Nietzsche : un renversement des valeurs opéré par les faibles pour justifier leur incapacité à vivre.
En élargissant à « l’histoire des prêtres et des philosophes, y compris celle des artistes », Nietzsche dénonce l’ensemble de la culture occidentale, fondée sur le mépris du corps.
La formule finale est ironique :
« Ce ne sont pas les impuissants, pas les ascètes qui dirigent leurs flèches empoisonnées contre les sens, ce sont les ascètes impossibles… »
Autrement dit, ceux qui condamnent le désir sont souvent ceux qui en souffrent le plus. Leur morale n’est pas lucidité, mais vengeance du faible contre la vie.
: La morale ascétique n’est pas une élévation spirituelle, mais la manifestation d’une impuissance vitale déguisée en vertu.
Dans cet extrait, Nietzsche opère un renversement des valeurs morales traditionnelles : ce que la tradition chrétienne ou philosophique appelait « pureté », « chasteté », « victoire sur le désir », n’est, pour lui, que signe de maladie.
Loin d’être sages, les ennemis du corps sont des êtres dégénérés, incapables de vivre et d’assumer la puissance de leurs instincts.
Ainsi, le philosophe substitue à la morale du renoncement une morale de la force : la véritable santé consiste à intégrer le désir, à en faire une énergie créatrice, non à le nier.
L’ascète, chez Nietzsche, n’est pas un modèle de vertu, mais un symptôme de décadence — l’ombre de la vie qui s’éteint.
Ouverture :
Cette critique prépare les grands thèmes de La Généalogie de la morale : la morale chrétienne y sera analysée comme la revanche des faibles sur les forts, et la philosophie de Nietzsche comme un appel à la renaissance du corps et de la volonté de puissance.