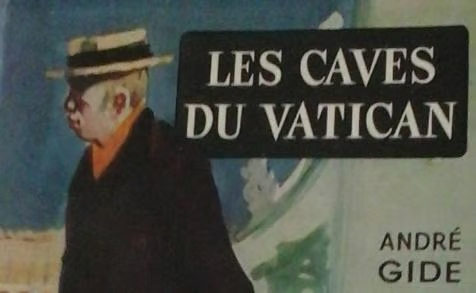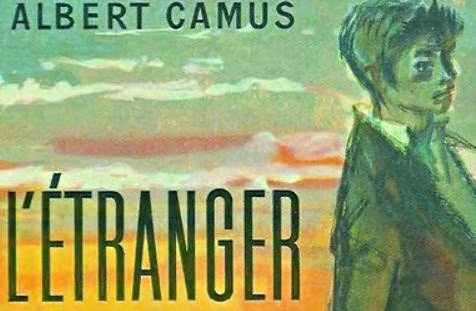Exploitations philosophiques des œuvres littéraires au bac de français
Les œuvres étudiées en classe de Première pour le bac de français ne sont pas seulement des objets d’analyse littéraire. Elles mettent en scène des personnages, des conflits, des passions, des dilemmes — autant de situations qui touchent à des questions philosophiques fondamentales : qu’est-ce que la liberté ? le désir nous rend-il heureux ? la morale s’oppose-t-elle à l’amour ? comment vivre en société ?
Cette rubrique propose d’explorer les prolongements philosophiques des grandes œuvres du bac.
Tu y trouveras :
- des éclairages notionnels (désir, liberté, bonheur, morale, société…),
- des analyses thématiques de textes,
- des sujets types de dissertation de philosophie intégrant les œuvres,
- des outils pour penser les liens entre littérature et philosophie.
Les enjeux philosophiques de Manon Lescaut :
désir, liberté, bonheur, morale et société
Le roman Manon Lescaut de l’abbé Prévost, inscrit au programme du bac de français en Première, ne se limite pas à une histoire d’amour tragique. À travers la passion dévorante du chevalier Des Grieux pour Manon, il donne chair à des questions philosophiques majeures, qui touchent au désir, à la liberté, à la morale, au bonheur, et aux rapports entre l’individu et la société.
- Peut-on aimer sans perdre sa liberté ?
- Le désir est-il un moteur vital ou une source de souffrance ?
- Jusqu’où peut-on transgresser la morale au nom de l’amour ?
- La société condamne-t-elle les passions ou nous protège-t-elle d’elles ?
- Peut-on être heureux quand on vit contre les normes sociales ?
Cette page propose d’examiner Manon Lescaut sous un regard philosophique, en croisant les analyses littéraires avec les grands penseurs (Spinoza, Rousseau, Kant, Schopenhauer…), pour nourrir aussi bien la réflexion en Première qu’en Terminale.
Et si la littérature nous permettait de mieux comprendre la philosophie ?
Manon Lescaut, roman emblématique du XVIIIe siècle, raconte l’histoire passionnée et tragique de Des Grieux, jeune homme qui renonce à tout — raison, honneur, avenir — pour suivre une femme qu’il aime jusqu’à l’aveuglement. Mais ce récit romanesque est aussi une véritable matière à penser.
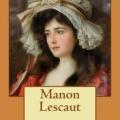 1. La passion
1. La passion
Portée philosophique :
La passion, chez Des Grieux, est un affect dévorant qui s’impose à la volonté. Il s’agit d’un exemple parfait de ce que les philosophes comme Descartes ou Spinoza appellent une passion : un mouvement de l’âme subi, qui échappe au contrôle de la raison. Le héros perd son autonomie de sujet rationnel : il est « esclave » de sa passion.
Chez Spinoza, les passions sont des effets de causes extérieures que l’on ne comprend pas. Des Grieux illustre cette impuissance du sujet : il sait qu’aimer Manon le mène à la ruine, mais il ne peut s’en empêcher.
En parallèle, la passion peut être vue comme une forme d’expérience existentielle : chez Rousseau ou même chez les romantiques, la passion donne une intensité à la vie que la raison seule ne peut offrir. C’est ce que vit Des Grieux, prêt à tout sacrifier pour cet amour.
Manon Lescaut pose donc la question centrale : faut-il choisir la raison ou la passion, la lucidité ou la vitalité affective ?
Bilan :
Problématiques possibles :
- La passion est-elle un obstacle à la liberté ?
- Faut-il fuir les passions pour être heureux ?
- Peut-on être lucide quand on est passionné ?
Exploitation :
- Le chevalier Des Grieux est emporté par sa passion pour Manon, au point de trahir sa vocation religieuse, ses principes moraux, sa famille, la loi.
- Il illustre le pouvoir destructeur des passions, mais aussi leur intensité : « Je sentis que j’étais devenu l’esclave de ma passion ».
- Son parcours montre que la passion peut rendre aveugle, mais aussi donner un sens à la vie, aussi tragique soit-il.
L’amour de Des Grieux est total, irrationnel, dangereux.
- Il illustre ce qu’est une passion : un trouble de l’âme, un emportement incontrôlable.
- Pour certains philosophes (Spinoza, les stoïciens), c’est un piège, pour d'autres (Nietzsche, les romantiques), une force vitale.
- Tu peux montrer que la passion peut être une forme d’aliénation ou d’intensité vécue selon la vision du monde qu’on adopte.
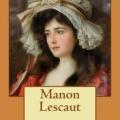 2. La liberté
2. La liberté
Portée philosophique :
Le roman est une étude de la dépendance : Des Grieux se croit libre lorsqu’il quitte Saint-Sulpice, mais il devient totalement dépendant de Manon. Il agit par impulsion, par nécessité affective.
Cela rejoint l’idée de liberté d’indifférence chez Descartes ou Spinoza : tant que je suis guidé par mes affects, je ne suis pas libre ; je suis conduit, non par moi-même, mais par ce qui me détermine de l’extérieur.
La liberté véritable, selon Kant, réside dans l’autonomie morale, c’est-à-dire dans la capacité à se donner à soi-même la loi. Des Grieux, en renonçant à ses principes moraux, abdique cette liberté au profit d’un amour possessif.
Mais le roman montre aussi une tentative désespérée de conquérir la liberté face à une société oppressive : Manon cherche une liberté matérielle, Des Grieux une liberté affective. Cela ouvre à une lecture sociologique ou politique de la liberté : la liberté est-elle possible dans un monde structuré par les inégalités ?
Bilan :
Problématiques possibles :
- Sommes-nous maîtres de nos désirs ?
- L’amour rend-il libre ?
- Être libre, est-ce faire ce que l’on veut ?
Exploitation :
- Des Grieux croit être libre en suivant Manon, mais il est en réalité aliéné par son désir et sa dépendance affective.
- Manon, elle, joue d’une certaine liberté, mais son goût du luxe et sa peur de la misère la rendent aussi prisonnière de ses choix.
- Le roman suggère que la liberté peut être compromise par des passions irrationnelles ou des déterminismes sociaux.
Des Grieux est-il libre quand il suit son amour pour Manon ?
- Il agit contre sa volonté rationnelle, sous l’emprise de la passion : il perd sa liberté intérieure.
- Il illustre ce que Spinoza ou Kant appellent un homme non libre, esclave de ses désirs.
- Tu peux utiliser Des Grieux pour dire que la vraie liberté, c’est la maîtrise de soi, pas la soumission à ses émotions.
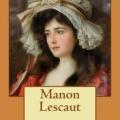 3. Le bonheur
3. Le bonheur
Portée philosophique :
Le bonheur semble être la visée des deux amants. Mais leur poursuite du plaisir (luxe, amour, évasion) les éloigne de toute forme de bonheur durable. Cela rejoint l’opposition antique entre :
Hédonisme (Épicure) : rechercher le plaisir mesuré, stable ;
et Stoïcisme (Sénèque, Marc Aurèle) : rechercher la paix de l’âme par le détachement.
Des Grieux, en s’abandonnant à des passions violentes, s’épuise et souffre : son malheur est la conséquence de son incapacité à maîtriser ses désirs. Il illustre le fait que le bonheur demande une forme de tempérance, voire de sagesse, comme l’enseignent les sagesses antiques.
Mais le roman pose aussi la question moderne : le bonheur doit-il être un état stable, ou peut-il résider dans l’intensité des émotions, même tragiques ? Pour certains penseurs comme Nietzsche, la vie intense vaut mieux qu’une existence tiède et raisonnable.
Bilan
Problématiques possibles :
- Le bonheur est-il compatible avec la passion ?
- Le bonheur dépend-il de la vertu ?
- Peut-on être heureux sans sagesse ?
Exploitation :
- Le bonheur que cherchent Des Grieux et Manon est toujours fugitif : ils goûtent des instants de joie, mais l’instabilité de leur relation et les scandales la rendent impossible à long terme.
- Des Grieux sacrifie tout pour une forme de bonheur intense mais éphémère : on pourrait y voir une opposition entre hédonisme et eudémonisme.
- Le roman devient une forme de méditation sur l’illusion du bonheur lorsqu’il repose sur la passion et non sur la raison.
Les deux héros cherchent le bonheur dans l’amour et le plaisir… mais ne trouvent que souffrance.
- Le roman montre qu’un bonheur fondé sur les désirs instables est fragile et trompeur.
- Cela rejoint les idées des philosophes antiques (Épicure, les stoïciens) qui valorisent la mesure et la paix intérieure.
- Tu peux montrer que Des Grieux confond plaisir immédiat et bonheur durable.
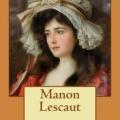 4. La morale / le devoir
4. La morale / le devoir
Portée philosophique :
Le roman illustre une transgression permanente des normes morales et sociales : vol, mensonge, séduction intéressée. Mais cette transgression est portée par une logique amoureuse et affective : est-elle alors légitime ?
La tension entre devoir moral et désir personnel est au cœur de la pensée kantienne. Pour Kant, la morale repose sur une loi universelle et rationnelle. Des Grieux, en suivant sa passion, agit par inclination, non par devoir. Il serait donc immoral au sens kantien.
Mais le roman peut aussi se lire à travers une morale du cœur : comme chez Pascal, les raisons du cœur échappent à la logique rationnelle. L’amour n’est pas forcément immoral ; il obéit à une autre logique.
On peut aussi mobiliser Hegel : la morale n’est pas purement individuelle. Les personnages sont broyés par les contradictions entre leur subjectivité et les normes sociales. Ce conflit est au cœur de toute éthique moderne.
Bilan :
Problématiques possibles :
- Peut-on désobéir à la morale au nom de l’amour ?
- L’homme doit-il toujours suivre la raison ?
- La morale s’oppose-t-elle aux désirs ?
Exploitation :
- Des Grieux transgresse les normes sociales et religieuses pour suivre Manon.
- Il se débat entre sa formation religieuse (à Saint-Sulpice) et ses élans amoureux : tension entre le devoir et le désir.
- Le roman illustre bien une opposition entre la morale kantienne (agir par devoir) et une morale plus sentimentaliste.
Des Grieux transgresse toutes les normes pour Manon : il ment, trahit, vole.
- Cela pose une question centrale : doit-on suivre son cœur, ou faire ce qui est juste ?
- Chez Kant, agir moralement, c’est suivre une loi valable pour tous / Des Grieux est donc immoral.
- Tu peux utiliser le roman pour illustrer le conflit entre désir personnel et devoir moral universel.
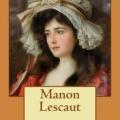 5. La société / les déterminismes sociaux
5. La société / les déterminismes sociaux
Portée philosophique :
Manon Lescaut peut se lire comme une critique sociale voilée. Le récit met en lumière le poids des inégalités, la corruption des élites, l’hypocrisie des institutions (religieuses, judiciaires).
Manon est en quelque sorte victime de sa condition : jeune, pauvre, belle, dans un monde patriarcal, elle a peu de moyens pour s’en sortir autrement que par le charme et la ruse. On peut la rapprocher d’une figure rousseauiste : née bonne, mais pervertie par la société.
Des Grieux, bien que noble, se heurte à la rigidité d’un ordre social où l’amour transgressif est puni. Cela illustre le fait que les individus ne sont pas entièrement libres : leurs choix sont conditionnés par leur position sociale, leurs affects, et les attentes de leur époque.
Le roman anticipe ainsi des thèses sociologiques modernes (Bourdieu, Durkheim) sur la place du déterminisme dans la formation des trajectoires de vie.
Bilan
Problématiques possibles :
- Sommes-nous libres de choisir notre vie ?
- La société rend-elle l’amour impossible ?
- Les inégalités peuvent-elles justifier l’immoralité ?
Exploitation :
- Manon est contrainte de séduire pour survivre : sa condition de femme pauvre dans une société patriarcale et corrompue explique en partie ses choix.
- Le roman critique l’hypocrisie sociale : les institutions religieuses, judiciaires, et les classes sociales empêchent un amour sincère d’éclore.
Manon est jugée, condamnée, envoyée en exil car elle ne rentre pas dans les cases sociales.
- Le roman critique l’hypocrisie de la société, les injustices sociales, la difficulté à exister librement quand on est pauvre, jeune, femme.
- Cela permet de réfléchir à la part sociale de nos choix et aux déterminismes qui pèsent sur nous.
- Tu peux montrer que le roman pose la question : sommes-nous vraiment libres dans une société injuste ?

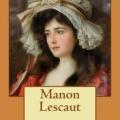 1. La passion
1. La passion