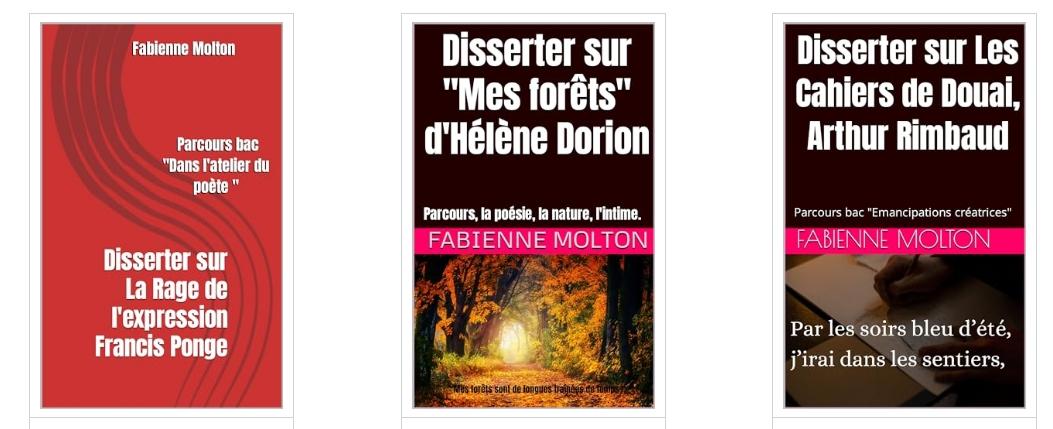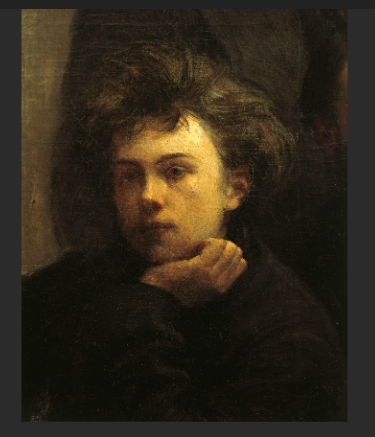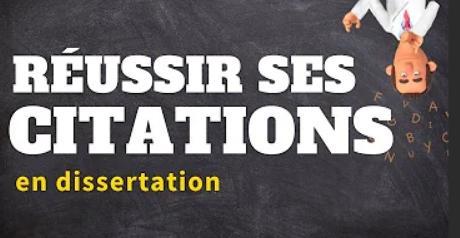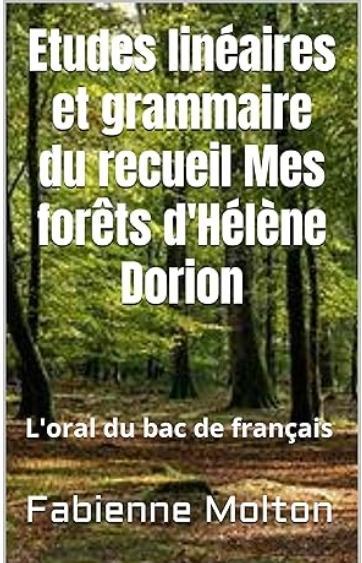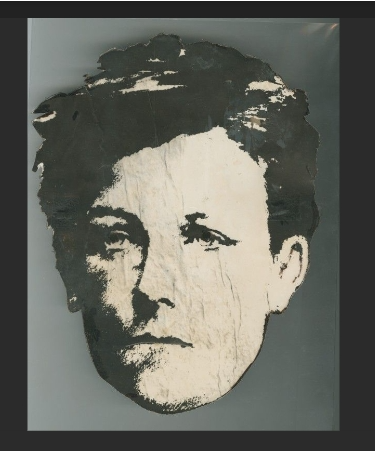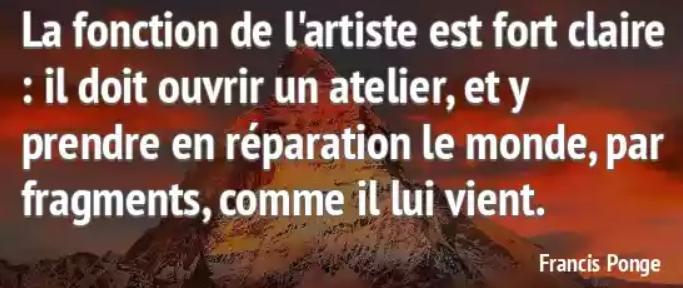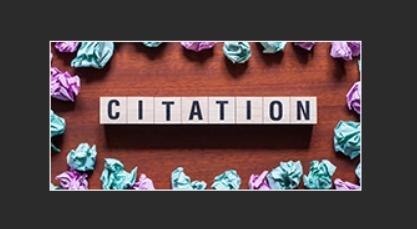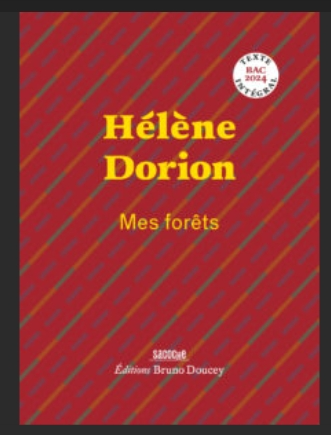Qui est Rimbaud?
Qui est Rimbaud?
Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à Marseille à 37 ans des suites de sa tumeur au genou, l'infection s'est généralisée
Il écrit ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans en s'inspirant des modèles littéraires de Baudelaire, Théodore de Banville, Victor Hugo pour les thèmes mais dépasse ces influences en créant des ruptures. Le poète doit se faire « voyant », c'est-à-dire chercher et décrire l'inconnu par delà les perceptions humaines usuelles. Il se libère des contraintes formelles d'écriture et innove radicalement
Rimbaud est reconnu comme l’un des pionniers du symbolisme, mouvement littéraire et artistique de la fin du 19 ème siècle
Arthur Rimbaud est à la croisée de plusieurs mouvements littéraires. Il est considéré comme l'un des plus grands poètes français et appartient au mouvement symboliste mais il est influencé par le romantisme, il y trouve le lyrisme comme dans "Ophélie" . Il est aussi attiré par le mouvement du Parnasse mais s'en éloignera. Son influence majeure est "Les Fleurs du mal" de Baudelaire dont le Spleen et L'idéal font écho dans Une saison en Enfer et Illuminations. Sa poésie cherche à dépasser les apparences, voir les symboles tout en s'inspirant des correspondances cachées qu'il cherche à déchiffrer
Il entretient parallèlement une aventure amoureuse tumultueuse avec le poète Paul Verlaine, qui influence profondément son œuvre.
Des poèmes comme « Le Bateau ivre », « Le Dormeur du val » ou « Voyelles » comptent parmi les plus célèbres de la poésie française. La précocité de son génie, sa carrière littéraire fulgurante, sa vie brève et aventureuse contribuent à forger sa légende et faire de lui l'un des géants de la littérature mondiale.
 Rencontre avec Georges Izambard (janvier 1870)
Rencontre avec Georges Izambard (janvier 1870)
En janvier 1870, alors en classe de rhétorique, Arthur Rimbaud se lie d'amitié avec Georges Izambard.
De cette époque datent ses premiers vers publiés : « Les Étrennes des orphelins », parus dans la Revue pour tous en janvier 1870. L'orientation poétique est alors celle du Parnasse, sous l'influence de la revue collective Le Parnasse contemporain.
Lettre à Théodore de Banville (mai 1870)
Le 24 mai 1870, Arthur Rimbaud, alors âgé de quinze ans et demi, écrit au chef de file du Parnasse, Théodore de Banville. Dans cette lettre, il transmet ses volontés de « devenir Parnassien ou rien » et de se faire publier. Pour cela, il joint trois poèmes : « Ophélie », « Sensation » et « Credo in unam ». Banville lui répond, mais les poèmes en question ne paraîtront pas dans la revue.
Son poème À la musique témoigne de son mal-être de vivre à Charleville
Première fugue à Paris (août-septembre 1870)
29 août 1870, Rimbaud trompe la vigilance de sa mère et se sauve avec la ferme intention de se rendre à Paris.
Contrôlé à son arrivée en gare du Nord, il ne peut présenter qu'un billet de transport irrégulier, le voilà détenu dans la prison Mazas.
De sa cellule, il écrit à Georges Izambard, à Douai, pour lui demander de payer sa dette. Le professeur exécute sa demande et lui paie également le voyage pour se rendre à Douai, lui offrant l'hospitalité avant de le laisser retourner à son foyer.
Rimbaud arrive à Douai vers le 8 septembre. Redoutant le retour à Charleville, il y reste trois semaines
Rimbaud fait la connaissance du poète Paul Demeny, un vieil ami de son hôte. Celui-ci est codirecteur d'une maison d'édition. Rimbaud saisit l'occasion et, dans l'espoir d'être édité, lui dépose une liasse de feuillets où il a recopié quinze de ses poèmes.
Recueilli par son professeur Georges Izambard après sa première fugue du 29 août 1870, Rimbaud déposa dès le 26 septembre 1870 chez Paul Demeny, poète et éditeur douaisien, une première liasse de 15 poèmes. Il fera un second séjour à Douai lors de sa deuxième fugue. Sept nouveaux sonnets seront confiés à Demeny. Les deux liasses seront vendues aux enchères de l'hôtel Drouot en 1914 et achetées par Stefan Zweig.
Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud
1. Contexte et présentation de l’œuvre
Les Cahiers de Douai correspondent à un ensemble de poèmes écrits par Arthur Rimbaud entre 1870 et 1871, alors qu’il est adolescent (16-17 ans). Ces poèmes, adressés à ses amis poètes ou destinés à la publication, marquent ses premiers pas dans la poésie et annoncent déjà l’originalité et la modernité qui feront sa renommée.
Écrits dans un contexte d’instabilité (guerre franco-prussienne, siège de Paris), ces poèmes mêlent réflexions personnelles, révolte contre l’ordre social et quête poétique.
2. Problématique
Comment les Cahiers de Douai traduisent-ils la tension entre la révolte adolescente, la quête d’identité et l’expérimentation poétique, dans une poésie renouvelée par le regard neuf de Rimbaud ?
3. Axes d’analyse
A. La révolte contre la société et la guerre
Rimbaud, jeune poète, exprime une forte contestation face aux normes sociales, à l’autorité et à la guerre.
Le contexte de la guerre franco-prussienne (1870) est très présent, notamment dans « Le Dormeur du val », où la nature idyllique contraste violemment avec la mort tragique du soldat, dénonçant l’absurdité et la cruauté du conflit.
L’insoumission rimbaldienne s’exprime aussi dans son refus des contraintes poétiques traditionnelles, ainsi que dans son mode de vie hors normes, annoncé déjà dans ses poèmes.
Cette révolte est aussi celle d’un adolescent qui rejette la morale bourgeoise, l’éducation reçue, et revendique une liberté totale, notamment dans « Ma Bohème », célébration de la vie errante et libre.
B. La quête d’identité et le regard du poète
Rimbaud apparaît comme un poète en pleine construction de son identité, entre rêve et réalité, entre désir d’évasion et ancrage dans le réel.
Cette quête identitaire est visible dans les nombreuses figures du voyageur, du vagabond, de l’explorateur qui parcourent les poèmes (« Roman », « Ma Bohème »).
Le « je » poétique est très présent, incarnant une subjectivité intense et souvent conflictuelle, oscillant entre exaltation et mélancolie.
Le regard porté sur le monde est neuf, curieux, parfois ironique ou désabusé, ce qui marque une rupture avec la poésie romantique traditionnelle.
C. La nature entre idéal et réalité
La nature tient une place centrale : elle est tour à tour refuge, miroir des émotions, et cadre du drame humain.
La description minutieuse de la nature dans « Le Dormeur du val » crée un contraste fort entre beauté paisible et réalité tragique.
La nature est aussi lieu d’évasion et de liberté, un espace où le poète peut rêver et se construire, comme dans « Roman », où la mer symbolise l’infini et l’aventure.
Parfois, elle est animée, presque personnifiée, participant à la charge émotionnelle des poèmes.
D. L’innovation poétique et la modernité
Les Cahiers de Douai témoignent d’une expérimentation du langage, du rythme et de la forme.
Rimbaud renouvelle la poésie lyrique en abandonnant la rigueur classique : vers courts, ruptures rythmiques, images audacieuses.
L’usage de métaphores frappantes, de comparaisons originales, crée une poésie visuelle et sensorielle.
Le poète anticipe les mouvements symbolistes et surréalistes, en donnant une place centrale à l’inconscient, aux sensations et à l’imagination.
Cette modernité contribue à faire des Cahiers de Douai un moment clé de la poésie française.
4. Étude thématique d’extraits clés
« Le Dormeur du val » : le paysage idyllique crée une attente positive, mais la chute révèle la mort d’un jeune soldat, dénonçant la violence de la guerre et la perte de l’innocence. La nature apparaît complice dans ce contraste.
« Ma Bohème » : exaltation de la liberté, du voyage et de la vie vagabonde, où le poète se construit en marge de la société. L’image du poète errant forge l’identité rimbaldienne.
« Roman » : poème de l’évasion et du rêve, où la mer est le symbole de l’infini et de l’aventure intérieure.
Les Cahiers de Douai constituent un jalon essentiel dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud, mêlant révolte adolescente, quête d’identité et renouvellement poétique. Par une écriture audacieuse et un regard neuf sur le monde, ces premiers poèmes annoncent la naissance d’un poète visionnaire, capable de bouleverser les codes et de donner naissance à une poésie moderne, à la fois intime et universelle.

 Qui est Rimbaud?
Qui est Rimbaud?  Rencontre avec Georges Izambard (janvier 1870)
Rencontre avec Georges Izambard (janvier 1870) S'émanciper est le fait de s'affranchir, de se libérer d'une dépendance, d'une autorité...
S'émanciper est le fait de s'affranchir, de se libérer d'une dépendance, d'une autorité...